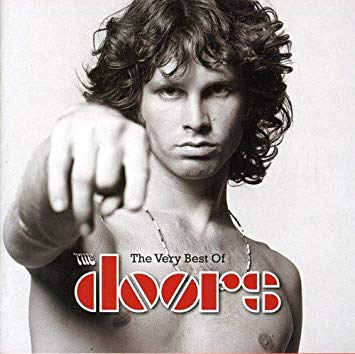Alors que son époustouflant Whiplash émerveillait avec peu de moyens, Damien Chazelle s’est lancé dans un projet de grande envergure avec cette fresque sur l’arrivée du parlant à Hollywood. Etrangement, la fin de l’ancien monde et de ses déboires donne ici lieu à un recyclage jusqu’à l’épuisement de scènes et de motifs éculés, jusqu’à son climax ridicule, digne d’un lycéen en spé ciné. Babylon choque non pas tellement à cause de sa vulgarité permanente ou de ses excès, mais plutôt par sa profonde vacuité et son manque d’ambition esthétique.
Dès le premier quart d’heure, deux sentiments contradictoires émergent : le malaise et la lassitude. Un éléphant défèque dans la bouche de pauvres types et une femme urine dans la bouche d’un homme nu, parallèle inutilement vulgaire entre les hommes de l’ombre prêts à perdre toute dignité pour intégrer Hollywood, et ceux qui en profitent. La séquence est en fait une référence à l’Affaire Arkuble, indirectement à l’origine du code de censure, dit « code Hays », que j’évoque plus en détail dans cet article. Curieusement, en entrant dans les festivités, Chazelle parvient à ennuyer. Son plan d’entrée, qui se voudrait magistral avec une caméra ultra fluide, semble être un écho, réjouissant mais peu inventif, de la fête de ce génial et trop peu connu film de Max Ophuls, Le Plaisir (1952 déjà !). Passons sur cet emprunt possiblement non voulu, Babylon sera beaucoup plus lourd sur ses inspirations au fur et à mesure de l’intrigue.
La construction du film en fragments entremêle les destins de différents acteurs de l’âge d’or d’Hollywood avant le son. Comme Huit et demi (1963) ou plus récemment Once Upon A Time in Hollywood (2019), Babylon fait le choix de la juxtaposition de séquences plutôt qu’un récit plus classique, ce qui donne lieu à des passages plus ou moins intéressants et pertinents, comme l’inutile mais symapthique séquence de la bataille contre le serpent. A l’inverse, quelques rares séquences brillent réellement par leur rythme, comme celles des tournages, à l’instar de celui de la recherche de la caméra et des premiers problèmes causés par le son sur le plateau. Relevons au passage la magnifique parenthèse accordée au chanteur de jazz confronté au racisme.
Le récit choisit de manière classique de nous faire suivre le destin d’un nouveau venu dans ce monde fantasque, pour faciliter l’identification. D’autres personnages sont sous les feux de la rampe, comme la délurée Nelly LaRoy (Margot Robbie) qui devient une star, le flegmatique et charmeur Jack Conrad (Brad Pitt), acteur déjà confirmé et adulé, ou encore les exclus de ce système comme Fay (Li Jun Li). De cette optique, même si la construction des personnages reste assez prévisible, Babylon montre sans manichéisme les acteurs de l’ombre d’Hollywood et la relation paradoxale du grand écran avec les minorités.
Malheureusement, le film échoue à créer un vrai lien émotionnel avec les personnages. Certes, Manuel Torres, joué par le prometteur Diego Calva, est un personnage-relais solide, bien qu’assez monolithique. Si Nelly LaRoy s’avère attachante, grâce à la folie qu’insuffle Margot Robbie, elle n’est pas réellement touchante, malgré la tentative trop vite esquissée par la découverte de sa mère à l’asile. Pris dans un rythme effréné, cette séquence perd son potentiel émotionnel. De même, le personnage joué par Brad Pitt, assez similaire de ceux qu’il a déjà incarné chez Tarantino, suit une progression assez attendue. Le scénario aurait peut-être gagné en subtilité en ne montrant pas son suicide, geste tristement logique après son dialogue, assez beau d’ailleurs, avec la terrible journaliste. Et c’est là peut-être une des erreurs répétées du film: ne pas faire confiance à son spectateur. En effet, Babylon ne suggère rien et préfère tout montrer. Dans une logique de surenchère permanente, ce choix est compréhensible, mais présuppose l’émerveillement du spectateur, donc sa passivité, plutôt que son intuition. A l’inverse, un cinéaste comme Fellini, lui aussi intéressé par l’univers de la fête et du cirque, et dans une même veine méta, l’entremêle de rêves et d’une mise en scène onirique pour suggérer son aspect fantasmatique et sa folie.
Il convient maintenant d’évoquer le vrai problème de Babylon : son absence de propositions esthétiques. Dans un film centré sur l’arrivée de la voix au cinéma et sur la fin du silence, bon nombre d’innovations et d’idées de mise en scène étaient espérées, Damien Chazelle n’en fait rien. Pire, il copie presque entièrement les trouvailles d’autrui. A la première séquence reprise de Chantons sous la pluie, on sourit ; à la cinquième ou sixième, on ne peut que soupirer. De plus, Chazelle a l’audace de montrer à la fin les séquences qu’il a lui-même refaite, comme pour avouer son manque total d’ambition. Je reviendrai plus en détail sur cette séquence finale qui parvient à cumuler en cinq minutes tous les défauts du film.
S’il aurait été payant et presque obligatoire dans un film méta, de faire quelques allusions à d’autres films, Babylon se noie dans une abondance de citations évidentes. Chazelle peine à trouver une demi-mesure dans sa conglobation de références. Il reprend ainsi le plan culte de l’ouverture de Sunset Boulevard (1950) avec Brad Pitt en faux mort dans la piscine, mais surligne le clin d’œil avec l’appel de ce même personnage à Gloria Swanson, héroïne tragique et ambiguë de ce même film. Il avait déjà superposé les références dès le début avec l’arrivée de Fay, en tenue inspirée de Marlene Dietrich, avec la coupe garçonne de Loulou (1929) dans une chanson lascive que n’aurait pas renié Jessica Rabbit. Qu’apporte Damien Chazelle alors ?
De manière plus générale, Chazelle accumule les clichés : tous les liquides (sperme, vomie, urine, sueur…) pour montrer les excès, personnages constamment en train de baiser au second plan pour montrer la folie, il ne manquerait plus qu’un filtre rouge pour montrer les Enfers. Ah mais il le fait aussi ! Dans une étrange séquence, Chazelle plonge ses personnages dans les bas-fonds d’Hollywood, dans des étranges célébrations des excès perdus. Pour ce faire, Babylon reprend le motif classique depuis l’Antiquité de la descente aux enfers, appelée catabase dans un jargon plus pédant, avec la descente des escaliers des personnages pour suggérer la gradation dans l’horreur des « spectacles ». Malheureusement, alors que la séquence se veut anxiogène et dérangeante à souhait, elle tourne plutôt au ridicule avec une surenchère de kitsch et de glauque facile, entre combats d’esclaves et monstres hérités de Freaks (1932).
Inévitablement, il nous faut évoquer le final de Babylon et son mash up de films cultes. Malheureusement, peut-être qu’il comptait sur la naïveté du spectateur pour son « hommage » au cinéma (par ailleurs uniquement occidental au vu des films choisis). Alors qu’elle se voulait sans doute un plaidoyer pour la capacité du cinéma à émerveiller en salle, la séquence tombe dans le ridicule, à croire que le monteur a seulement tapé « films cultes » sur YouTube et s’est servi. Tout y est, la séquence de la découverte du monde d’Oz par Dorothy, les larmes de Jeanne d’Arc et d’Anna Karina devant La Passion de Jeanne d’Arc (triple mise en abyme wow), le vaisseau de 2001… Et entre Godard et Bergman, un petit passage d’Avatar. De surcroît, Chazelle, dans son mash up de scènes revues mille fois, a l’audace de vouloir inscrire son film dans l’histoire du cinéma. Relevons tout de même la seconde partie de ce montage, plus épileptique et abstraite, qui, malgré sa grandiloquence assumée, est éclipsée par la première moitié risible. Finalement, en nous montrant les films qu’il a copié durant le sien, Chazelle parvient peut-être à ses fins, nous faire retourner en salle ; la prochaine fois, on préférera les soirées UGC cultes dans ce cas.