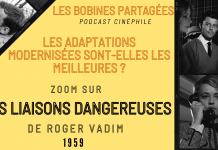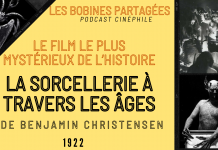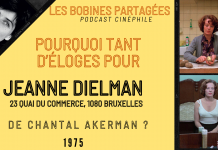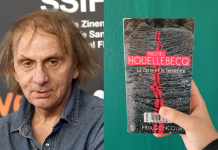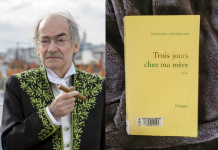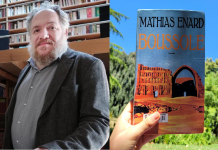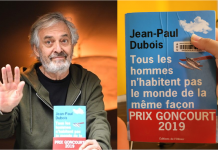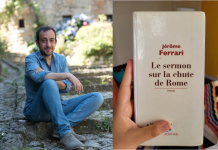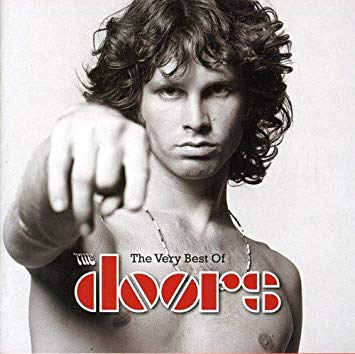L’éternel recommencement du mois de septembre. La rentrée littéraire. Les sorties cinéma après un été en demi-teinte. La frénésie de découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux lieux et de nouveaux films. De ce tourbillon exaltant, restent des images de cinéma fortes, assurément en mémoire pour un bout de temps, et d’autres visions, déjà évanescentes. C’est l’heure du micro bilan critique des sorties et ressorties.
Valeur sentimentale de Joachim Trier
Je n’avais vu de ce réalisateur norvégien, étoile montante portée aux nues à chaque festival de Cannes, que Julie (en 12 chapitres), qui m’avait beaucoup déçue. Je lui ai redonné sa chance avec Valeur sentimentale, chronique de deux sœurs qui, à la mort de leur mère, retrouvent leur paternel cinéaste qui avait claqué la porte des années auparavant.
Quelque chose cloche dans ce film trop parfait, trop cinématographique. Face à ce scénario si bien huilé, ces décors millimétrés, impossible de trouver une brèche pour se glisser dans le film, pour s’émouvoir. Visuellement stupéfiant, Valeur sentimentale est bien conscient de ses atouts formels. Je suis donc restée de marbre devant ce film, qui se referme plutôt qu’il ne s’ouvre vers nous. Dommage, car il recelait de trouvailles passionnantes, et d’interprètes solides.
L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme de Pierre Richard
Un fable sympathique mais poussive dans lequel un vieil homme incarné par Pierre Richard lui-même, et un jeune autiste se lient d’amitié avec un ours. En résulte un film familial un peu trop bon enfant, et un peu trop mou, sur l’importance de préserver la nature. Quelques amusantes séquences oniriques en clin d’œil à la carrière de Pierre Richard raviront les fans.
Sirat d’Oliver Laxe
Hypnotisant et sensoriel puis brusquement ultra-violent, Sirat nous plonge dans des raves parties clandestines au milieu du désert, et nous emporte bien plus loin, aux portes de l’enfer. Complètement imprévisible, le scénario prend la forme d’une transe lancinante, puis change de tempo sans crier gare. S’ensuit une traversée du désert aux confins de la mort dont on sort sonné. Rares sont les films à produire des effets aussi viscéraux. Retrouvez ma critique complète ici pour en savoir plus.
Oui de Nadav Lapid
Produit en partie par des fonds israéliens directement liés au pouvoir, et traitant de façon discutable du génocide en cours à Gaza, Oui bénéficie d’une promotion enthousiaste sur les médias traditionnels, tout en étant boycotté sur les réseaux sociaux. Je suis quand même allée le voir, pour découvrir si un artiste israélien qui se dit dissident, peut l’être en effet dans son œuvre. Ce film suit Y, artiste précaire sommé d’écrire un hymne à la destruction de Gaza.
Oui s’avère un cas d’école complexe, lui-même piégé dans l’obscénité des puissances qu’il prétend fustiger. Bruyant, vulgaire, orgiaque, faussement ambigu (cf la scène du baiser devant Gaza bombardée…), Oui coche toutes les cases du parfait petit film contestataire, d’un conformisme pas si courageux.
De plus, la construction décousue du film, décadence dans la première partie, crise morale dans le désert en deuxième partie, et création artistique ironique en troisième partie, nous perd et nous épuise. Oui brasse large mais entre peu en profondeur. Que pense réellement un artiste israélien de son pays, de sa société ? Le personnage principal, artiste, est figé dans une posture de grand enfant, peu propice à la réflexion, ou à la critique.
Miroirs n°3 de Christian Petzold
Après un accident de voiture, une jeune femme, Laura, est recueillie par Betty et sa mystérieuse famille. Miroirs n°3 s’engage à demi-mot sur le film de fantômes, une piste fantastique qui m’aurait intéressée, hélas trop vite balayée pour préférer un drame réaliste sur les traumatismes familiaux. Résulte un film d’une subtilité quasi soporifique, où les micro-gestes veulent faire événement. Ce manque de tensions, additionné à une intrigue répétitive, m’a laissée dubitative et marque une première rencontre un peu ratée avec le réalisateur Christian Petzold. Je poursuivrai l’exploration de son œuvre une autre fois, un jour où je serai bien réveillée.
Soundtrack to a Coup d’Etat de Simon Grimonprez
Je triche car je n’ai pas vu ce film en septembre mais à la Quinzaine du cinéma francophone au Centre Wallonie Bruxelles il y a un an. Cet étrange film, déstabilisant, m’avait profondément marqué, au point d’y repenser des mois après. Repenser à ce flot d’images, ce montage dingue sur le rythme du jazz, cette histoire, trop méconnue, du détournement d’une révolution par les puissances néo-coloniales. Soundtrack to a Coup d’Etat n’est pas un film simple d’accès, mais plutôt une expérience, une variation ayant pour point de départ le rôle du jazz dans la décolonisation du Congo. Le jazz devient moins un sujet du film, qu’une façon de penser, de monter, de rythmer ce film qui s’émancipe de toute règle, toute norme. N’y voyez pas un documentaire didactique, explicatif, mais une plongée vertigineuse, très ardue par son rythme et sa masse d’information certes, mais passionnante. Restent longtemps en tête ces images, parfois cocasses, parfois glaçantes, et une en particulier, le visage de Patrice Lumumba, libérateur du Congo sauvagement assassiné avec l’aide des Etats-Unis.
Du côté des ressorties :
Palombella Rossa (1989) de Nanni Moretti
Film improbable sur le papier (un député communiste frappé d’amnésie prend part à un match crucial de water-polo), Palombella Rossa avait anticipé la dissolution du parti communiste italien. Le (re)voir aujourd’hui s’avère un exercice compliqué, à la fois réjouissant pour la performance toute en ironie et en auto-dérision de Nanni Moretti, et ardue. Ardue car le film, comme souvent chez Moretti, est bavard, très référencé, et erratique. S’ajoute à la chronologie floue du film, un contexte politique assez confus pour la jeune spectatrice que je suis. Me sont alors restées les images époustouflantes de water-polo, d’un génie comique qui lui, reste intemporel.
Entre le ciel et l’enfer (1963) d’Akira Kurosawa
Gondo (Toshiro Mifune), un industriel japonais s’apprête à payer une rançon démentielle au kidnappeur de son fils, avant de réaliser que ce dernier a fait erreur et à enlevé le meilleur ami du fiston, un petit prolétaire, fils du chauffeur de Gondo. Après moult dilemmes éthiques, Gondo accepte de se ruiner pour sauver le petit, et fait appel à la police pour gérer la transaction. S’ensuit une stupéfiante séquence de traque, véritable morceau de bravoure cinématographique qui culmine en une scène dans un train. La recherche du kidnappeur s’achève dans de sordides bas-fonds, aux antipodes des décors luxueux du début.
D’une virtuosité inégalable, Entre le ciel et l’enfer questionne l’intégrité de l’homme, sa liberté, comme le système économique tout entier, et s’invite dans chaque classe sociale sans manichéisme. Exceptionnel thriller, doublé d’une étude morale passionnante, ce film reste un des sommets du maître Kurosawa.
Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow
Adepte des films suffocants, à la tension quasi insoutenable, Kathryn Bigelow nous souffle, encore une fois, avec Zero Dark Thirty, récit de dix ans de traque de Ben Laden. Dans un montage nerveux d’une efficacité redoutable, le film nous immerge avec réalisme aux côtés des agents de la CIA, au plus près des doutes et de l’obstination de l’une d’entre elles, Maya (Jessica Chastain). Chaque avancée dans l’enquête se double d’un attentat surprise, d’une attaque imprévue qui bouleverse tous les plans. Au bout de deux heures trépidantes, Zero Dark Thirty s’offre le luxe d’une leçon de cinéma et de montage en guise de séquence finale, avec l’exécution de l’ennemi public n°1. On découvre que l’être humain était capable de ne pas respirer pendant 2h30.