Les candidats du concours avaient cinq mois pour m’envoyer une nouvelle sur le thème du rock. J’ai reçu trente-cinq textes tous très riches et remarquablement écrits. Le choix n’en a été que plus difficile, c’est au bout de maintes relectures que j’ai pu établir le beau palmarès final que voici !
Le gagnant du concours est Christophe Thibal pour son texte « Ça c’est rock’n’roll ». Quatre autres textes complètent le palmarès. Il s’agit de « Long live rock’n’roll » de Jean-Michel Clerc, « Le souffle court » de Laurence Gay Pinelli, « Le jour où j’ai tué John Lennon » de Jean-Michel Galiot et « Rock around the cloud » de Pierre Malaval. Vous trouverez ces cinq beaux textes à la fin de cet article.
Je tiens à remercier de tout coeur l’ensemble des candidats du concours d’avoir participé à cette première édition du concours de nouvelles de ce site. Celui-ci évolue et change à présent de nom pour refléter le tournant plus cinéphile qu’il a pris ces dernières années. Ainsi, la page rock du site se tourne, et se clôt en beauté grâce à vous.
Et maintenant… place aux textes !
Ça c’est rock’n’roll
Je connaissais assez Jack pour savoir qu’il était furax lorsque Julie, à moitié à poil, passa devant lui pour aller s’habiller dans la salle de bain.
« T’es sûr qu’elle est majeure celle-ci ? » me demanda-t-il ?
-Julie ! Bien sûr qu’elle est majeure, bonne comme elle est y a aucun doute ! »
-Déconne pas Edith, en ce moment c’est pas le moment de te faire un détournement de mineur je te rappelle que t’as le discours devant les mecs de l’académie française »
C’est vrai, j’allais intégrer l’académie française, moi, Edith Bobchran celui que les journaleux surnommaient l’intellectuel du Rock. Jack était inquiet, c’était normal, il était mon agent. Il avait peur de perdre du fric. Pour le rassurer je gueulais :
« Hey Julie t’as quel âge ?
-Je m’appelle pas Julie, je m’appelle Mina !
-Tu fais chier, je te demande pas ton nom, mais ton âge !
-Seize ans pourquoi ? »
J’ai cru que Jack allait s’étouffer en entendant sa réponse.
« Edith, je me fais chier à te faire une carrière et toi tu déconnes en baisant une mineure, tu m’emmerdes Edith, tu m’emmerdes… »
Il alla se servir un verre de whisky en prenant la bouteille qui était sur la table et c’est là qu’il est tombé sur la coke.
« Merde ne me dis pas que tu lui en a fait prendre en plus ?
-Pourquoi tu crois qu’elle était aussi bonne ? ironise-je.
-Edith je ne sais pas ce qui me retiens de te laisser tomber ?
Le fric que je te laisse peut-être ?
Merde Edith, la coke, la fille mineure ça fait beaucoup à une semaine de l’intronisation ?
Ça c’est Rock and Roll mec ! » conclu-je
C’était mon expression préférée, je la sortais à longueur de temps, même dans les interviews soigneusement choisies par Jack.
Ce qui m’avait valu le surnom d’intellectuel du rock, c’étaient mes chansons. Les textes étaient reconnus par les principaux critiques prout prout de l’intelligentsia parisienne. Les critiques trouvaient ça génial. L’écart entre la beauté des textes et mon attitude de rocker devaient plaire. Mes excès, mes dérapages étaient pardonnés grâce mes chansons. Si ces cons savaient ! Seul Jack, Richard et moi savaient ! Et ça c’était vraiment rock !
Richard était un pote d’enfance, lui l’introverti, moi tout le contraire. Quand on a commencé à jouer dans le garage de son vieux pour jouer ses chansons, il était caché derrière sa basse. Au premier concert que l’on avait fait sur la remorque d’un tracteur, je faisais le cabot sur scène et lui allait vomir dans les bottes de foin… Richard n’était pas rock c’était évident. Très vite il a quitté le groupe, mais on est resté pote. Puis on a commencé à être connu sur la scène
départementale. C’est là qu’un soir il est venu me voir, je me souviens de notre conversation comme si c’était hier.
« Philippe, tu sais à quel point j’aime écrire et à quel point je déteste être mis en avant, alors j’aimerai te proposer un deal !
-Accouche mec !
-J’ai écouté votre dernier concert, c’était cool. T’as une voix de dingue, tes riffs guitares sont à tomber mais tes paroles sont à chier…
-Si c’est pour dire que mes textes c’est de la merde t’avais pas besoin de venir, je le sais.
-J’écris pour toi, je ferme ma gueule et tu dis que c’est toi !
-Tu y gagnes quoi ?
-La joie de voir mes textes chantés et la moitié de ce que tu gagnes avec ! »
C’est à partir de ce moment-là que ma carrière s’est mise à décoller… Ces textes m’inspiraient des riffs diaboliques et ça a marché ! Il ne me restait plus que remplacer Philippe par Edith, ça c’est rock, et je devenais une légende : l’intello du rock !
Je tenais ma parole et lui filait la moitié des droits d’auteur, d’ailleurs j’avais intérêt car avec la coke et l’alcool j’étais de plus en plus incapable d’écrire une traitre ligne, je savais juste les sniffer !
Richard écrivait mes discours, mes chansons… Jack s’occupait de tout le reste… Moi je faisais le show et je m’éclatais dans tous les sens du terme. Bon avec le temps peut être que nos rapports s’étaient un peu tendus.
Julie… Ou Mina de toute façon je ne me rappelle jamais de leur prénom avait quitté la chambre d’hôtel. Jack continuait à tourner comme un fauve. Malgré la gueule de bois j’avais compris qu’il avait autre chose à me dire.
« Edith faut que tu freines sur la coke, ça rend agressif !
-Pourquoi tu dis ça, je t’ai fait de la peine ma poule ?
-Je ne parle pas de moi, je parle de Richard…
-Qu’est-ce qu’il a encore ce cul serré, je ne lui donne pas assez de fric ?
-Ce n’est pas le problème, mais un peu plus de reconnaissance de ta part ne serait pas de trop…
-Putain il me fait chier, ce n’est pas compliqué pour lui, derrière son ordinateur dans sa maison de campagne avec sa femme et ses gosses. Il ne mouille pas trop la chemise lui !
-Oublie pas que sans lui tu n’es rien ! Il m’a dit que t’avais été plus que limite avec lui hier ! Il m’a dit qu’il voulait tout plaquer…
-Tout plaquer pour quoi faire ?
-Il veut écrire des nouvelles et des romans.
-Ah ouais il m’en a parlé, l’autre jour il voulait faire un concours de nouvelles. Tu sais ce qu’il y avait à gagner dans ce concours de tocard ? 50 balles ! C’est avec ça qu’il va nourrir ses chiards ? Il m’a dit que ça l’intéressait et qu’en plus le thème était le rock !
Qu’il écrive pour ces toquards et quand il faudra qu’il change de bagnole il reviendra vers moi !
-Ou vers d’autres ! Putain appelle le pour t’excuser… »
Le lendemain j’étais un peu redescendu. J’avais un peu réfléchi et Jack n’avait pas tout à fait tort. Fallait pas que je merde surtout devant les académiciens et j’avais besoin de Richard. Je composais son numéro.
« Salut Richard, ça va ? »
Silence au bout du fil…
« Bon ok, j’ai un peu abusé la dernière fois, je m’excuse.
-On dit « excusez-moi » pas je m’excuse… »
J’avais envie de le crever mais je fis profil bas.
« Je comprends que tu sois à cran, mais on a tous les deux à y perdre, il faut vraiment que tu m’écrives ce discours… »
Un long silence s’en suivit.
« Je veux me lancer dans l’écriture de nouvelles, je t’avais dit de le faire toi-même, va falloir que tu t’émancipes un peu !
-Merde fais pas l’enculé, tu me l’écris ce discours !
-Je vois que tes excuses n’ont pas fait long feu…
-Je te rappelle que c’est grâce à moi que tu gagnes ton fric !
-Qui sait j’aurai peut-être gagné plus ailleurs…
-Tu le fais oui ou merde !
-Bon si j’ai fini ma nouvelle, je le ferai passer à Jack avant ta cérémonie, mais seulement si j’ai le temps… De toute façon tu les découvres toujours devant l’assemblée tu ne prends même pas le temps de les regarder avant…
-Et oui mec, parce que ça c’est rock and roll, un truc qui te dépasse ! »
En raccrochant je savais qu’il le ferait, de toute façon il lâche toujours l’affaire, lui, il n’est pas rock and roll !
J’avoue qu’à deux heures de l’intronisation alors que je n’avais toujours pas reçu le discours, je flippais un peu. J’avais envoyé Jack relancer ce cul serré de Richard, je savais que lui le convaincrais. J’attendais devant les marches, il me restait deux minutes et toujours rien.
Je vis une forme courir et suer arriver du fond de la rue. C’était Jack. Il tenait dans sa main une enveloppe. Richard n’était vraiment pas rock, non seulement il ne m’avait pas planté, mais en plus il utilisait toujours les mêmes enveloppes. Ce vieux papier kraft avec au moins une dizaine de feuilles à l’intérieur. Que m’avait-il préparé ce coup-ci, j’espère que ça ne sera pas trop chiant… Quel angle allait-il prendre, j’allais le découvrir devant les académiciens.
Devant le pupitre je décachetais l’enveloppe. Je sortis les feuilles et au regard du nombre le discours risquait d’être long.
C’est en voyant le contenu que j’eu une montée d’adrénaline. Pourtant je n’avais pas pris de coke ce matin… La sueur perlait sur mon front… La première page était blanche ! La deuxième aussi ! Rien n’était inscrit sur les feuilles sauf sur la dernière.
En caractère gras au milieu de la feuille il y avait inscrit avec un gros doigt d’honneur dessiné dessous… « ça c’est rock and roll ! »
Long live rock’n’roll
Appelez-moi Le King. Je règne sur mon domaine, le roi en son royaume.
Je vise plus haut, je suis Dieu.
Le dieu du rock pour le moins.
Le dieu du riff.
Derrière ma Les Paul me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Le King, le Roi des Dieux !
Je règne sur l’empire du rock n’ roll.
Je viens de naître. J’ai cent ans, j’ai mille ans. Je suis l’alpha et l’omega de la musique des rois.
Je traverse la Chaîne du Riff, alpiniste du mode mineur. Avec mes six cordes je grimpe au sommet du monde des guitar heros.
En sympathie pour le diable, mes airs d’harmonica m’emportent dans le vent comme le zeppelin de Led Zepellin.
Je n’ai pas fini, laissez-moi parler. 26 ans trois quart, bientôt mort. Depuis ma tour en cuir de serpent immortel je rêve au club des 27. Mon panthéon du rock glisse entre mes doigts, slide sur le manche de ma guitare. Je transpire le blues par tous mes pores.
Mon âme vendue à Robert Johnson en sympathie pour le devil. Au milieu de la fumée je m’enfuis, mon esprit vole déjà dans le septième ciel. J’ai fracassé les portes du pénitencier, le désert m’attend. Anges ou démons laissez-moi. Je dois vivre, vivre, baiser, cracher sur vos tombes. Je veux montrer de quel bois ma guitare vous chauffe. Chauffe les oreilles, le coeur, les tripes. Poumons remplis, acajou et noyer, je me jetterai du pont sur la Tallahatchee mon ode à Billy Joe. Laissez-moi vivre encore, un peu, une fois, noyer mon blues.
Je veux goûter au monde à la folie aux filles à la joie à la scène. Juste une fois s’il vous plaît. Anges ou démons, ma sympathie pour le devil Robert Johnson, je franchis le croisement du delta avec la route de Chicago.
Depuis ma petite turne sous les toits, je vis je respire, le staccato de mes cordes, j’en pince pour le rock et ma pédale wouah wouah. Où es-tu Johnny Cash ? sous mon aile de corbeau tout en noir caché ?
Je veux voler, te dévoiler, ange ou démon je te désire, vas-y sors Johnny ! Fais-moi mal, vas-y Johnny !
Je m’effondre sur mon matelas aux draps défaits. Terrassé par mes effets.Wah-wah !
Au réveil, la corne sur mes doigts me brûle encore. Je suis en sueur. J’ai frotté mes cordes toute la nuit jusqu’au petit matin. L’ampli est encore chaud. Les voisins du dessous sont partis au boulot sans rien dire. Je vais encore entendre Delphine. Delphine c’est ma proprio. Elle habite au second.
Les mains dans la glace du freezer, je respire l’air glacé. Un fond de vodka me sourit, je tends les bras. Le liquide en fission transperce ma croûte terrestre inonde mon corps. Les doigts gourds, ma gourde transie de froid, mon corps lourd, saisi d’effroi par l’alcool. Je retombe sur ma couche trempée
pour plonger dans des rêves de stars du rock déchues.
Mes doigts sonnent dans le silence des arpèges. De lents ils virevoltent, de plus en plus rapides. J’entends dans mon crâne. Les cloches de l’enfer déciment les hordes barbaresques. Cauchemar. Il fait quarante degrés sous mon toit. À ma petite lucarne le toit blanc de la basilique. Je rêve de la voir peinte en grande meringue rose comme quand Spinoza encule Hegel. Anarchy en Chiraquie !
Trois cent euros par mois du vol. De ma lucarne je baise les anges et tutoie mes démons. Pas de
douche dans ma chambre de bonne. Juste un évier qui goutte, un matelas, une table et une chaise. Ma Les Paul et mon ampli Marshall pour seule fortune. Mes vêtements sur une planche, ma bibliothèque et mes cassettes.
Deadline avant d’être viré. Quatre mois de loyer en retard. J’ai cherché où j’ai pu. Trouvé : pas grand-chose. Ça suffira pour l’instant. On m’a prêté un flingue. Prêt à faire sauter les caisses des épiciers. Prêt à trouver les mille balles qui manquent. Prêt à tout en sympathie pour le devil.
Je m’asperge d’eau tiède au robinet par-dessus la vaisselle sale. J’enfile mon Levi’s, mes doc. Chapeau, lunettes, débardeur noirs. La gratte dans son étui, clic. Le flinguot dans la ceinture, le sac à dos, l’ampli à la main. La porte clac. Zip la pierre du briquet. Frsht la clope incandescente. La descente d’escalier. Tap-tap-tap.
Je m’arrête au second. Delphine me guette à sa porte. C’est une jeune divorcée de la haute. Elle est
jolie. Un mois durement gagné, pas assez de la rue, des cachets des concerts, des rares séances d’enregistrement en studio. J’ai fait un épicier hier après-midi. J’ai eu les boules. Je me suis défoncé toute la nuit. Il me manque que la télé, le show-biz pour réussir à m’en sortir, à me payer mes shoots et mon boui-boui. Je pourrais me payer une fille comme Delphine si je passais à la télé.
Delphine me fait entrer boire un café. Son grand appart fait dix fois ma chambre. Trois pièces séjour,
tout en blanc et vitres et plantes vertes. Elle m’allume, je le sens. Capsule nespresso, petite tasse design.
Je la suis vers sa chambre. Elle n’a rien à cacher. Elle ouvre une petite boîte sur son bureau, y engouffre mes trois cent balles.Je vois les autres billets dépasser, qui veulent sortir quand elle ouvre. La chaleur éreintante du flingue contre mes reins. Je ne le sens pas. Elle me fait asseoir sur le bord de son lit. Elle
allume un joint, me le fait passer et commence à me caresser.
« Oh mon Charlie ! Mon petit guitar hero ! Quand deviendras-tu sage ? Quand trouveras-tu un vrai travail ? »
Mon flingue me brûle la peau. Je m’enfuis de chez elle avant qu’elle n’aille trop loin. Et moi aussi.
Elle crie « N’oublie pas ! Ce soir dernier délai ! »
Je veux passer une dernière journée à tutoyer anges et démons, sympathy for the devil. Je trouve un coin de rue, pose le micro sur son pied, branche l’ampli, la guitare.
Mississippi Fred Mc Dowell
le feu jaillit de mon sang
« You got to move, you got to move
You got to move, child, you got to move
But when the Lord gets ready
You got to move »
Les paroles percent ma carapace.
« You may be high, you may be low
You may be rich, child, you may be poor
But when the Lord gets ready
You’ve got to move »
Mon coeur brille de mille éclats. Les larmes me montent aux yeux.
Je prends feu, je me consume dans mes cordes, dans mes paroles.
Un solide riff bien rock au bout des doigts. Je ne m’arrête pas. Il est temps de partir dit la chanson. Le signal m’est donné. La rue est animée mais je dois partir. C’est un signe que m’envoie la chanson. Je reprends le refrain longtemps, le répète avec toute la force qu’il me reste.
Applaudissements, sifflets à chaque nouveau riff, chaque nouvelle phrase. Une vingtaine de passants arrêtés. Le chapeau se remplit.
L’anonyme du trottoir devient guitar hero.
Après Fred McDowell, c’est MuddyWaters, c’est John Lee Hooker, c’est Chuck Berry et Elvis.
Avec Johnny Cash je m’embrase à nouveau, les foules s’enflamment se consument, deviennent braise. La rue se transforme, fosse de concert. Fosse des Mariannes. Fossoyeur en chef j’enterre Marianne.
Le soleil brille haut et descend au-dessus des immeubles haussmanniens. Le soleil se reflète sur mon
corps en flammes. Je baise le soleil brûle les anges. Le public aime ma voix bien timbrée. Le plus timbré des rockers de Panam de Babylone. Babylon’s burning sous mes doigts.
Dans le métro j’entreprends un public différent. Moins de riffs, plus d’arpèges, plus soft. Je vois les écouteurs qui s’écartent des oreilles, les yeux se lever des téléphones portables et des rares bouquins. Mes doigts virevoltent.
« I’ve been a minor for a Heart of Gold »
Neil Young
À une station j’entends un saxophoniste le temps que les portes restent ouvertes.
Innocent, au milieu de Neil Young, je reprends la mélodie du saxo pour improviser derrière quelque chose qui me transporte, m’emporte loin au-delà de la rame, au-delà des galeries, des escaliers et des toits parisiens.
Envie de me défoncer.
Je descends, guitare et ampli dans les mains, je sors, allume une cigarette. Le flingue me chauffe les
reins. Je marche quelques minutes. Il est temps de partir.
Je monte à l’appart. L’odeur d’herbe dans l’escalier. Les temps sont durs. Je fonce aux toilettes me faire un fix.
Je respire mieux. Le premier de la journée.
Je me sens plus léger. Mes pas précèdent mon corps. Je volette loin au-dessus de la mêlée.
Je suis déf, ça fait du bien. Je branche l’ampli, la gratte. Les copains se joignent à moi. Les joints se succèdent. Basse, guitare, batterie. Des bouteilles des boulettes de shit. On décolle bientôt. Ce soir je vais m’envoler haut. On joue dans un bar à Bagnolet. Le public est un peu froid au début mais je monte
rapidement au maximum de mes capacités. Je me suis refait un fix avant le concert. J’atteins le nirvana.
Le public est en surchauffe. Je mène le set jusqu’à son terme. On n’arrive pas à s’arrêter. J’épuise mes
camarades. Je vais au bout de moi-même. Demain j’aurai 27 ans. Pas le temps de traîner. Je dois entrer ce soir au panthéon du rock. Demain est un autre jour.
À la sortie de la boîte, je suis adulé.
Je dois m’y mettre. Je rentre chez moi. Pénètre chez Delphine. Elle m’attendait. Petite nuisette.
Je sors mon flingue. Enlève la sûreté. Mon index se crispe sur la détente.
Delphine crispée devant moi.
Je pense à tout son fric caché dans sa boîte. Je pense à Crime et châtiments. Au châtiment sans le
crime. Sympathy for the devil. My heart of gold. You gotta move. Il est l’heure de partir.
Je la force à se déshabiller. Je suis le King du rock’n’roll. Ce soir j’ai droit à une gâterie. Je voudrais que Delphine se penche en avant sur son lit. Elle n’a peur de rien, ni du flingue ni de moi. Je suis le dieu du rock’n’roll ! Je vais mourir demain, j’y ai droit !
Delphine est passée derrière moi. Je n’ai pas le temps de me retourner, une masse énorme s’écrase sur mon crâne. Les morceaux d’un gros vase explosé en vol. Les morceaux par terre dans mon sang. Je perds l’équilibre. Je m’effondre en arrière. Ma vue se floute. Delphine à moitié nue, le flingue dans les
mains. Une furie. Elle tire.
Je n’y vois plus rien. Je quitte ce monde. Je n’ai pas 27 ans et je meurs déjà. Long live the King.
Bienvenue mon pote.
Sympathy for the devil.
Le souffle court
Depuis le milieu de journée, une vilaine carie enrayait chacun de mes gestes. Las de redouter la brutalité d’un larsen dont l’intensité augmentait heure après heure, je cherchais le numéro d’un dentiste quand l’appel du permanencier est arrivé. Secourir un sans domicile fixe dans les grandes villes, pour un urgentiste, c’est devenu le pain quotidien. Celui-là tombait mal. Noël approchait, les grandes avenues étaient prises d’assaut et pendant que les bonnes consciences libéraient leurs pulsions consuméristes dans les magasins, un homme agonisait sous un ciel captif de lumières artificielles. De quoi donner la gerbe, même à un routinier du genre humain comme moi. J’ai avalé un antalgique et remis ma prise de rendez-vous à plus tard.
Il était allongé dans un fatras de vêtements sans couleurs à même le pavé gelé au début d’une petite impasse perpendiculaire à la rue Oberkampf, mais ce qui a retenu mon attention, c’est l’air qu’il fredonnait. Un air qui ne m’était pas inconnu, que j’avais beaucoup écouté il y a longtemps, avant de l’oublier… Du gros son. Il a levé ses yeux vers moi comme s’il avait entendu mes pensées.
–
Jethro Tull – Aqualung, du grand Tull.
Aqualung ! Le morceau m’est immédiatement revenu en mémoire. Ce solo de guitare magnifique, la flûte, la pochette de l’album, le clochard effrayant… J’ai dû faire un effort pour me concentrer sur ma veste institutionnelle et lui poser la litanie des questions habituelles auxquelles, je n’ai eu aucune réponse. Il ne voulait pas m’entendre. Son souffle était court et du fond de son enfer, un seul souvenir remontait.
–Le rock, à l’époque, c’était tout pour nous. La musique, on la vivait, on la respirait. Tu pouvais être n’importe qui, fils de charcutier en province ou d’une élite à Paname ça changeait rien à la donne, au respect. Par contre, rocker, punk, rasta, disco, oui… Rocker c’était ma carte d’identité. J’ai dormi avec mon perfecto comme Joey le chanteur des Ramones, groupe mythique. Tu vois de quoi je parle ? Aujourd’hui, je dors plus, je tombe, mais il est toujours là.
Il a posé sa main sur un coeur qui ne battait plus qu’au rythme d’un morceau de rock’n roll des années soixante-dix. Mon stéthoscope s’offrait un live qui reléguait mon dentiste et tutti quanti aux calendes grecques. De mendiant, cet homme n’avait que l’allure. Seigneur venu d’un monde parallèle où rugit une énergie pure, je m’agenouille et pose ma conscience devant toi.
–RAP, techno, c’est l’époque… Ouais. Mais dire que 50 Cent c’est de la musique comme Aerosmith ou le Velvet, c’est un sacrilège. Je ne suis pas d’accord. L’électro, c’est de la boite à rythme, pas de la musique. Il suffit d’avoir un ordinateur et bam, bam, bam, tu poses le son… Je suis déçu par cette époque, j’en attendais le meilleur et le rock y était pour beaucoup, il pouvait tout changer. Un riff de Led Zep ou d’Hendrix c’est comme faire l’amour. Je te parle pas de sexe, je précise parce que la nuance… Je te
parle d’amour. Aimer. Aimer. Quand tu aimes trop, tu ne peux que craindre l’avenir, n’oublie pas ça.
La première rencontre chacun fait à sa manière. J’ai eu des flamboyants qui viraient ternes, des
fous magnifiques, j’ai eu la terre entière ou alors, je l’ai rêvée. Des fois, quand ils ne demandent
qu’à mourir, je leur apporterais bien des bonbons au lieu d’essayer de les sauver. Sauf que lui,
je ne voulais pas lâcher son regard, sa fièvre. J’étais prêt à lui attaquer la chair à même le sol
pour faire durer le tempo. On m’avait prévenu. Ca peut arriver. Dans un monde dans lequel la
parole ne se partageait plus dans les cafés, se résumant à d’indigestes juxtapositions de
certitudes et jugements à l’emporte-pièce sur des réseaux sociaux abscons, miroir d’une
humanité stérilisée, adepte du clivage, celui-là me disait qu’il restait une musique.
Le rock, ça fait basculer dans une galaxie où les sensations, les émotions sont démultipliées, t’es transcendé, tu deviens supérieur, ta vie n’est plus ce qu’elle est pour des milliards d’êtres humains, elle devient une expérience sans limites, unique. Le rock, c’est la transgression. Aqualung, le clochard pédophile, tu imagines un texte pareil, aujourd’hui ? Impossible ! J’étais prêt pour un nouveau monde, mais il n’est pas arrivé. Alors, j’ai fait comme tout le monde, j’ai accepté l’idée de ma médiocrité, j’ai avancé. Enfin, j’ai cru. Pas plus vite que les autres, pas mieux. J’ai rempli les contrats que ceux d’en haut nous mettent sous le nez ; job, maison, crédits. Un train d’enfer, mais sans paradis. De tout ça, il ne reste rien. Pourtant, dans ma tête, il y a ce son. La seule chose qui reste, c’est mon âme de rocker. Celle d’un merdeux de quinze ans qui a entendu Whole lotta love et compris que le ciel pouvait s’ouvrir sur des accords de guitare.
1976, concert de Johnny Cash pour les détenus du pénitencier de Nashville, Linda Ronstadt
toute en jambes fuselées d’Américaine, robe bleue vichy, voix de déesse, tient en respect, d’une main gantée et d’un tambourin, des centaines de gars, lie de la société en chemise bleu, priés de
faire oublier le temps du show qu’ils n’ont rien d’enfant de choeur. Moment de grâce initié par l’idole, l’homme en noir, Cash. J’ai dix ans. Le souvenir de la beauté de Linda, de ma prise de conscience devant le pouvoir du rock’n roll, me reviennent en tenant son bras aux tatouages usés. Cette histoire qui s’éteint sur des pavés gelés, devant moi, réveille celle d’un homme que rien n’intéressait plus, à peine une douleur dentaire.
– Le rock’n roll aurait pu changer nos vies, mais on s’est pris dans la gueule le train d’une mondialisation obscène, la loi d’un genre humain qui s’est fait refaire l’émail au rythme du CAC 40. L’histoire du billet de banque tu connais ? Je te parle pas de la
chanson de Lavilliers même si le gars a su nous faire monter très haut à une époque. Le texte, le son, y avait tout. Non mon frère, je te parle de l’histoire qui nous a renvoyé à quelques salles de concerts mal chauffées, nous a ringardisé. Tu sais la liberté, ce souffle propulsé par des guitares sur ma chevelure adolescente, la liberté n’existe que dans l’esprit. Nul par ailleurs. Sex & drugs & rock’n roll c’était quand même le slogan le plus accrocheur du monde ! Le jour où tout s’est mis à déconner c’est quand j’ai
enlevé mes bagues. Au début, j’ai pas eu l’impression de perdre mon âme, c’est venu lentement. Quand je croisais mon reflet dans la rue, je ne me reconnaissais pas. Pour être aimé, j’ai voulu faire comme tout le monde. Je me suis débarrassé de mon cuir, mes
bagouses et je me suis retrouvé à poil. Que dalle. Rien. Rien, pendant qu’en face, ils spoliaient l’historique. Vogue faisait sa couverture avec des pantins jugés plus authentiques et crédibles en perfectos à dix mille balles, bracelets à clous et crêtes
laquées par les plus grands coiffeurs de la place. Laisse-moi rire. De quoi débander aussi sec. J’ai compris qu’ils étaient en train de dénaturer ce mouvement, sa rage et je me suis senti fragile comme une porcelaine. Tu comprends ? Sans mon perfecto, je suis devenu l’homme invisible.
Non, il ne restait pas rien de son cuir sauvage. J’étais là. Je le suivais, l’accompagnais comme aucun autre avant lui. Dans ma tête, ses mots raisonnaient, me ramenaient au guerrier que
j’avais été, fantasmant son existence en clouant un poster de Thin Lizy sur les murs de sa chambre, rue des tilleuls, dans un petit village du sud-ouest de la France à sept cent trente
kilomètres et quarante ans d’une vie à Paris. Ses mots irriguaient mon cerveau. Il ne tiendrait plus longtemps et mon verbiage d’urgentiste manquait de rythme, de poésie, de descente dans
les abimes, de tripes. Je devais reconnecter avec la liberté, la mienne. Lui faire cette politesse pour le remercier de m’avoir rappelé le gout perdu d’un fruit merveilleux. Sous les regards
interrogateurs de mes collègues, j’ai posé ce matériel médical devenu décorum avant de prendre
mon téléphone pendant qu’il m’offrait ses derniers mots.
– Le perfecto c’était pas un déguisement, c’était moi. Pete Townshend le guitariste des Who a dit un jour « Quoi qu’il arrive dans le futur, le rock and roll sauvera le monde ». J’y ai cru…
De lui, je ne savais rien ou si peu. Ce qui l’avait aligné là, dans cette petite impasse, tel une ombre à même le pavé dans la froidure et la rigueur funeste de cet hiver. Chacun sa définition,
son plus grand artiste ou groupe, son plus grand morceau, pourtant, moi, le gugus fatigué, j’étais face à l’évidence, cet homme portait l’esprit éternel du rock’n roll. J’ai collé mon téléphone près de son oreille, cliqué sur la vidéo. Aux premières mesures, un sourire s’est ouvert sur son visage, dernière parenthèse carnassière et j’ai reconnu le clochard d’Aqualung.
Aqualung my friend, don’t you start away uneasy. You poor old sod, you see, it’s only me.
Le jour où j’ai tué John Lennon
Le 8 décembre 1980 à 22h52, John Lennon était assassiné de cinq balles calibre 38 Spécial, tirées par Mark David Chapman, devant le Dakota Building, où le Beatle vivait avec sa femme Yoko Ono.
Depuis les sixties, j’ai toujours été un grand fan de Lennon, et le jour de sa mort je me trouvais précisément à New-York, car je venais d’y emménager depuis peu.
La nouvelle de la tragédie frappa de stupeur de le monde entier, même ceux qui étaient plus Stones que Beatles…
Le 14 décembre vers 14 heures, des centaines de personnes se rassemblèrent à Central Park pour un hommage silencieux à l’artiste disparu. Ce furent dix minutes de silence qui furent observées. Raymond Depardon se trouvait à New-York ce jour-là, il filma en long plan-séquence cette foule muette, en état de sidération à la pensée de leur idole disparue. D’ailleurs on peut me voir dans ce court-métrage, je suis assis sur l’herbe, les genoux remontés sous le menton, le regard absent.
Le 8 décembre 2020, j’étais de nouveau dans l’Upper West Side, je remontais la 72e rue, à bord de ma vieille Styleline Deluxe. Je dois avouer que j’étais d’humeur plutôt joyeuse, il faisait un temps superbe, tout à fait inhabituel pour un huit décembre, les trottoirs étaient encombrés de New-Yorkais dont la plupart se dirigeaient vers Central Park. C’était un festival de robes un peu légères pour un jour d’hiver, on voyait même, parmi les joggers en combinaisons fluo, quelques chapeaux de paille et lunettes de soleil. Aussi, est-ce très décontracté que je conduisais ma Chevrolet 1952 qu’une voisine, tout juste veuve, venait de me vendre pour une bouchée de pain.
En suivant le flot de New-Yorkais vers Central Park, j’apercevais au loin le Dakota Building au croisement avec Central Park West, le Dakota Building où avaient vécu depuis les années 70, John Lennon et Yoko Ono dans l’appartement de Robert Ryan, acheté à la mort de ce dernier.
J’avais deux raisons de penser à l’assassinat de John.
D’une part, parce que nous étions précisément le 8 décembre, soit le quarantième anniversaire de sa mort.
La seconde raison était que, depuis un mois, Mark Chapman était au centre de toutes les conversations – avec la Bourse et le prochain Super Bowl de février.
A son procès, Mark Chapman avait écopé de la perpétuité, mais assortie de la possibilité de demander sa libération au bout de 20 ans, et ce tous les deux ans. La demande avait déjà été refusée 10 fois.
Pourtant, un mois avant ce 8 décembre 2020, contre toute attente, Mark Chapman s’était évadé de prison, caché dans un ballot de linge sale. Et, depuis,prison, caché dans un ballot de linge sale. Et, depuis, tous les journalistes essayaient répondre prison, caché dans un ballot de linge sale. Et, depuis, tous les journalistes essayaient répondre dans leurs articles, comme tout bon professionnel, aux cinq W leurs articles, Who, What, When, Why et Where.
Mais c’est sur le Where que les journalistes restaient muets. Or c’était surtout cette question qui passionnait les Américains : OÙ Marc Chapman pouvait-il se cacher ?
D’aucuns le disaient réfugié chez les Mormons, d’autres l’avaient aperçu sur la route 66 chevauchant une Captain America. D’autres encore certifiaient que Marc Chapman devenu ermite dans le Minnesota était mort, tué par un lynx.
Mais rien de tout cela n’était avéré.
Tout à ces pensées, j’arrivais au croisement de la West 72nd Street avec Central Park West. De loin j’avais vu que le feu était vert. Ainsi, au moment où je me portais à hauteur du croisement, les piétons étaient encore confinés sur le trottoir devant leur feu STOP.
Parmi eux, un personnage attira immédiatement mon attention. Je n’en crus pas mes yeux : ce New-Yorkais était John Lennon ! Aucun doute possible.
Il était tout de blanc vêtu, exactement comme sur la pochette d’Abbey Road ; les mains dans les poches, des chaussures blanches aux pieds, les cheveux châtain clair tombant sur les épaules.
Très impressionné d’être en présence de mon Fab Four préféré, je freinai instinctivement, et, pour lui être agréable, marquer ma sympathie, voire mon admiration, je lui fis signe de traverser. Peut-être aussi, dirait n’importe quel psychologue, pour établir naturellement, et inconsciemment, une connivence avec une célébrité, un lien subtil, même éphémère entre moi et un personnage mondialement connu.
John jeta un coup d’œil dans ma direction, m’adressa un signe de remerciement. D’un geste sec, il remonta ses lunettes rondes sur son nez, et allongea le pas.
Puis tout se passa en une fraction de seconde.
En même temps que John s’engageait sur la chaussée d’une large enjambée, j’avisai dans mon rétroviseur de gauche une camionnette frigorifique qui s’apprêtait à me doubler, sans, naturellement, avoir l’intention de s’arrêter à notre feu vert. Or le chauffeur ne pouvait voir mon Beatle traversant la rue, encore masqué à ses yeux par ma Chevrolet.
Quand le chauffeur aperçut John sur sa trajectoire, il tenta désespérément de freiner. En désespoir de cause, il braqua le volant sur la gauche.
La camionnette traversa le carrefour en diagonale, évita de justesse le Beatle, faisant claquer au passage un pan de sa veste blanche. Le véhicule finit sa course contre un lampadaire. De par sa vitesse et sa trajectoire courbe, la force centrifuge fit que les deux portes arrière s’ouvrirent, laissant se déverser sur la chaussée un amoncellement de cageots de fraises.
Vite ressaisi, je cherchai John des yeux. En vain ! Ce dernier avait disparu, enseveli sous les cageots !
Je descendis de voiture. Venus de toutes parts, des rues adjacentes ou sortant de Central Park, une kyrielle de John Lennon m’entourèrent et convergèrent vers le lieu de l’accident.
Des John Lennon vêtus de blouson de cuir et coiffés d’une banane comme en 1960, du temps de la tournée à Hambourg. Des John Lennon en costume à col rond et cravate ficelle, et coiffure mop-top. Des John Lennon issus tout droit du Magical Mystery Tour avec chapeau à plume et veste à rayures. D’autres vêtus du costume vert de Sgt. Pepper. D’autres enfin en pantalon noir et veste trois-quarts en fourrure brune, comme au rooftop concert de Savile road.
Des John Lennon comme s’il en pleuvait !
Tous ces Lennon s’affairaient déjà autour du tas de cageots, en dessous duquel gisait mon Lennon à moi, celui dont j’avais sans le vouloir précipité la mort.
Très rapidement, il me vint l’idée de fuir ce carrefour.
Certes j’avais provoqué cet accident, et même si je m’en sentais coupable, mon intention avait été au départ d’être agréable à John en lui faisant signe de traverser devant la Chevrolet, alors qu’il aurait dû attendre sagement sur le trottoir en compagnie d’autres piétons.
Il ne servait à rien de rester là, au beau milieu de l’attroupement. A priori, personne ne faisait attention à moi, ni ne vint me demander des explications sur la cause réelle de la tragédie. Au contraire, un policier me fit signe de dégager rapidement la chaussée pour permettre aux secours d’arriver.
Je ne demandai pas mon reste, regagnai la Chevrolet, attendit le plus calmement possible le feu vert, et démarrai pour disparaître au bout de la rue.
Le soir venu, je m’installai encore très perturbé avec une pizza devant la télévision allumée sur CNN. Je tombai sur une édition spéciale. Consacrée à Marc David Chapman.
On se souvient de l’évasion spectaculaire de Marc David Chapman du Centre de correction de Wende à Alden, où il était incarcéré depuis 2012, après son transfert d’Attica. L’assassin de John Lennon, le Beatle légendaire, s’était évadé après qu’un nouveau refus de mise en liberté avait été prononcé à son encontre. Et, depuis, Chapman s’était volatilisé dans la nature, sans que le FBI ne parvienne jamais à le localiser.
Or, il y a quelques heures, nous apprenons que Marc David Chapman a trouvé la mort à New-York , renversé par une camionnette de livraison de fruits, dans la West 72nd Street, c’est à dire, ironie du sort, devant le Dakota Building où il avait tiré à bout portant sur John Lennon.
Bien qu’il n’ait jamais été considéré comme fou par les experts psychiatres, Marc David Chapman n’en avait pas moins une attitude psychotique. Il avait épousé une Nippo-américaine, pour reformer un semblant de couple Ono – Lennon. Au moment de son homicide, Marc David Chapman avait sur lui le roman, qu’il affectionnait particulièrement de J.D Salinger, « l’Attrape-coeurs », tout comme John Hinckley qui tentera plus tard de tuer Ronald Reagan. Chapman avait également l’idée de tuer l’actrice Elisabeth Taylor. Tuer une personnalité du spectacle était pour l’assassin le moyen le plus sûr de passer à la postérité, et dans le cas de l’assassinat d’un Beatle d’associer définitivement son nom au plus fabuleux groupe de musique pop que le monde ait connu.
Depuis le 8 décembre 1980, et tous les ans à cette date, une centaine de fans se donnent rendez vous devant le Dakota Building pour un hommage à leur idole. C’est sans doute dans un esprit de pure provocation que Marc David Chapman s’était mêlé à eux cet après-midi, grimé comme tant d’autres en John Lennon. C’est avec le look du Lennon du rooftop concert, que l’un des assassins américains les plus célèbres depuis Lee Harvey Oswald et Charles Manson, a trouvé la mort cet après-midi. Tout comme Oswald, la célébrité de Chapman était non pas liée à sa personnalité intrinsèque mais à la popularité de sa victime, et d’ailleurs …
Je coupai le téléviseur ; ce que je venais d’apprendre me suffisait.
Mais je ne comprenais pas, soudain – et ne l’ai toujours pas compris encore aujourd’hui – pourquoi cet après-midi-là j’avais été persuadé à tort pendant un long moment avoir tué John Lennon, alors que je savais pertinemment qu’il était décédé 40 ans auparavant.
Je me levai pour mettre sur la platine vinyle un 45 tours pris au hasard dans ma pile de disques. Après quelques notes de mellotron, retentit la voix de John :
Let me take you down
‘Cause I’m going to Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Voilà, c’était exactement ça : j’avais laissé Marc David Chapman enseveli sous des cageots de fraises :
Strawberry for ever
Rock around the cloud
Quelque part dans les nuées sous la voûte céleste, ce mardi 5 décembre 2017. Un homme grand, corpulent, curieusement vêtu d’un jean et d’un blouson de cuir, santiags aux pieds, avance d’une démarche chaloupée jusqu’à une immense porte en bois à deux vantaux. Il se saisit du heurtoir dont il frappe par trois fois d’un mouvement vigoureux. Le bruit résonne dans les cieux comme sous les arches d’une cathédrale. « On dirait un pénitencier », se dit-il.
Une courte attente et la porte s’ouvre sans effort sur un beau vieillard à barbe blanche à qui
l’homme s’adresse d’une voix rocailleuse :
— Bonjour. Je m’appelle Jean-Philippe Smet, mais vous me connaissez mieux sous le nom
de…
— Johnny ! Oui je sais. Je vous attendais, vous étiez annoncé. Mon nom est Pierre, Saint-Pierre, et au nom du Père, je vous souhaite la bienvenue au Paradis.
Il a un sourire fatigué sur les lèvres ; toutefois, son affabilité rassérène quelque peu le nouvel arrivant.
— Je suis désolé de ne pas pouvoir m’attarder plus longtemps avec vous, mais je croule sous le travail. Pensez ! Un car de touristes hollandais qui vient d’arriver ! Il paraît que c’était un
véritable carnage sur l’autoroute, en bas, d’après Saint-Christophe qui n’a vraiment pas assuré sur ce coup-là. D’ailleurs le Patron est furieux et il enrage de ne plus pouvoir se fier à ses saints.
— Pas de problème, je peux me débrouiller en solo, je l’ai fait pendant toute ma carrière. Je trouverai bien un nuage disponible.
— Non, non ! Pas question de vous laisser vous installer tout seul. Aussi j’ai délégué un petit jeune fraîchement arrivé de chez vous tout juste hier : il va vous guider au milieu de tous ces
cumulus et vous aider à vous installer. Il s’appelle Jean. Tiens, le voici qui arrive ! Se présente alors un vénérable vieillard, sec, le cheveu blanc et ras, très élégant dans son costume tiré à quatre épingles et son éternelle cravate sombre.
— Bonjour Johnny ! Je vais vous accompagner pour votre installation parmi nous. Mon nom est Jean d’Ormesson.
Sourire un peu crispé des deux hommes lorsqu’ils se serrent la main, polis mais sans plus.
« Pourquoi m’avoir choisi moi pour accompagner ce type ? » se dit le dernier nommé.
« Hier, j’ai eu le bonheur d’être accueilli par Marguerite Yourcenar, comme pour me remercier de l’avoir fait entrer à l’Académie Française. Bon, une bonne action me fera peut-être bien voir en
haut lieu. Faisons contre mauvaise fortune bon coeur ».
« Pourquoi avoir choisi cet intello à deux balles ? » riposte Johnny Hallyday ; « Ils n’auraient pas pu m’envoyer Balavoine ? Au moins, on aurait bien rigolé. Tandis que là… Bon, faisons
comme chez les Enfoirés : Pour pas une thune, mais tous en choeur ».
C’est Jean d’Ormesson, désireux malgré tout de prendre son rôle au sérieux, qui essaye de rompre la glace :
— Qu’est-ce que j’ai pu danser sur vos tubes ! Quand j’étais jeune, naturellement, car à la fin de ma vie je ne sortais plus très souvent.
— Ah ! Moi, j’ai pas trop lu vos livres. A peine le journal du temps que vous travailliez chez Figaro.
— Dommage, répondit Jean d’Ormesson avec une pointe de regret dans la voix. Donc, Le
rapport Gabriel, par exemple, cela ne vous dit rien ?
— Gabrielle ? Vous avez connu Gabrielle vous aussi ? Moi, j’ai eu trop de rapports avec elle… Elle m’a eu à l’usure, et pourtant je suis un dur à cuire.
— Euh, oui, bon… Et sinon Au revoir et merci ?
— Ah bon ! Vous m’abandonnez déjà ?
— Non, c’est un autre de mes livres. D’ailleurs, je dois dire que j’étais parfois un peu irrévérencieux. Tenez par exemple, j’ai commis quelque ineptie sur le maître de ces lieux dans un autre ouvrage intitulé Dieu, sa vie, son oeuvre. A priori, il ne m’en a pas trop tenu rigueur.
Puis, prenant un air contrarié :
— Je dois avouer que je nourris une certaine jalousie à votre égard, car vous m’avez éclipsé ma mort, si je puis dire, votre trépas précédant de peu le mien. Mon arrivée au firmament s’en est trouvée altérée et mes obsèques là en bas risquent de passer inaperçues à côté des vôtres : vous aurez droit au minimum à un hommage national, moi je n’en suis pas sûr.
— Ah, désolé… Je me suis attardé un petit peu plus parce que j’ai voulu régler ma succession
avant de partir, histoire d’éviter les histoires de famille, si vous voyez ce que je veux dire.
Comment combler ce fossé qui sépare ces deux hommes, l’un, élégant et ironique, les yeux pétillants d’humour et d’intelligence, les lèvres sensuelles de l’homme qui aime les femmes et
le bon vin, dont le scepticisme souriant est trop éloigné de la rage passionnelle qui a toujours habité l’autre, chanteur viscéral et énergique, sorte de loup hurlant son mal-être ? L’un, fleurant
bon l’Ancien Régime, aux origines aristocratiques, et l’autre, né dans la rue comme il le chantait, au père absent et qui a dû s’inventer sa propre famille.
Alors, voulant relancer la conversation et tenter un rapprochement plus ostensible entre eux, d’Ormesson demande à Johnny :
— Une question qui me brûle les lèvres : comment, avec votre âge pas si avancé que le mien, certes, mais tout de même, pouviez-vous tenir le rythme effréné des tournées dans la France
entière ? Cela devait représenter une sacrée performance physique, n’est-ce-pas ?
— Ouais… mais j’avais mon petit secret, que je peux bien vous révéler puisque ça ne pourra plus sortir d’ici à présent : j’avais une doublure quand j’étais trop crevé.
— Pas possible ! Confidence pour confidence, je n’ai pas non plus tout écrit moi-même : j’avais un nègre.
— Euh, excusez-moi si je me permets : vous ne devriez pas parler comme ça, surtout ici. C’est
plus cool du tout de parler de nègre. Il faut dire « personne de couleur noire ».
— Non, il ne s’agit pas de cela : un nègre dans notre jargon d’écrivain, c’est une personne qui
écrit les livres signés par un autre. En fait, je ne me montrais que lorsque j’en avais réellement
envie. Pour les émissions de Bernard Pivot, par exemple, c’est moi qui m’y rendais.
— Et moi, pareil : j’ai assuré toutes les émissions d’Albert Raisner. Quand il fallait être
authentique, c’était moi. Pour la routine, c’était l’autre !
— Bon, laissons tout cela, voulez-vous. Ecoutez, je vais être franc avec vous, cette conversation
de bienséance m’ennuie un peu. Il y a longtemps que j’en ai perdu l’habitude, sauf à l’Académie
Française, cela va de soi. Certes, je suis bien né comme on dit mais il y a de cela bien longtemps. En vérité, je ne suis pas forcément celui que les médias ont fait de moi. Croyez-le si vous voulez, je suis un homme simple.
— Je le crois volontiers car pour tout vous dire, je ne pense pas non plus être le simplet des Guignols de Canal Plus. Ah bien sûr, je n’ai pas votre prestance intellectuelle ni vos beaux discours, mais si je connais peu la littérature, j’aime bien le cinéma, notamment. Mine de rien, j’ai tourné avec Lelouch, Godard, Costa Gavras, qui ne sont pas n’importe qui, non ? Ceci dit en toute modestie, naturellement. Tiens, voilà que je me mets à parler comme vous,
maintenant !
Un franc sourire de jeune homme, tel qu’il l’a toujours eu tout au long de sa carrière, illumine son visage. D’Ormesson part d’un rire de gorge haut perché.
— Voilà les pendules remises à leur place ! » ajoute Johnny en lançant un clin d’oeil ironique.
— Et puis tous les deux, nous avons une gueule, surtout vous : vous l’avez si bien chantée !
Pour une fois, si on les laissait tomber, nos gueules, nos masques, pour être nous-mêmes ?
— Si vous voulez, Jean. Rien ne me ferait plus plaisir… À bien y réfléchir, il y a autre chose que nous partageons vous et moi, outre nos yeux myosotis, c’est que nous sommes tous deux
immortels sur notre bonne vieille terre, n’en déplaise à notre hôte : vous en tant qu’académicien, moi car j’ai le rock’n’roll dans la peau et c’est bien connu : le rock’n’roll ne mourra jamais !
Yeah !
Jean d’Ormesson s’approche alors davantage de son interlocuteur et reprend d’une voix plus basse, presque énigmatique, comme s’il voulait ne pas être entendu :
— Voyez-vous, mon cher Johnny, à présent que je sens monter une franche amitié entre nous, je peux vous révéler ce que j’ai découvert et qui m’a fait un sacré choc… Nous sommes
cousins !
— Allez, vous me faites marcher…
— Pas du tout, ce n’est pas le genre de la maison. Nous descendons tous les deux de Marie et Catherine, deux filles d’un couple de seigneurs du Moyen âge qui vivaient près de Namur au
XVe Siècle : Jean de La Malaize et sa femme, Marie Smaele de Broesberghe. La branche Smet descend de Marie et la branche Ormesson de Catherine, donnant treize générations plus tard un
rockeur et un écrivaillon.
— Pas possible ! Ce monde est décidément tout petit. Qui aurait pu croire en une telle coïncidence ? On dirait un coup monté du Patron, comme l’appelle Saint-Pierre. Ça va leur faire drôle, en bas, quand ils vont l’apprendre.
— C’est une chose étrange à la fin que le monde !
— Allez, dorénavant, on se tutoie puisque nous sommes parents.
— Si tu veux, Johnny, mais à une condition… Appelle-moi Jeannot ! Et je t’emmène fêter ça au bistrot. J’ai repéré un petit nuage en contrebas, bien au frais, tenu par deux types vraiment
sympas, Estèphe et Emilion. Et aujourd’hui : Champagne !
— On a tous en nous envie d’Moët Hennessy !
En chemin, tout en s’appuyant sur le bras de Johnny, d’Ormesson ajoute d’un air comploteur :
— Il me vient une idée folle. Pourquoi ne pas organiser ici-en haut un concert de rock ? Il y aurait un sacré public – et même un public sacré ! – ça je peux te le garantir. Tu t’imagines
chanter « Hey Joe » accompagné de Jimi Hendrix à la guitare ? Ce serait géant, non ?
— Mouais… Mais qu’en dirait notre hôte ?
— Oh ! Je crois qu’il est un peu comme nous : il mène sa vie comme il l’entend, sans se soucier
des modes qui font qu’on doute de plus en plus de lui, il impose toujours le respect par sa seule prestance. Je crois savoir aussi qu’il a une sensibilité à fleur de peau.
— Ah oui, je vois : il a la rock’n’roll attitude, lui aussi.
— Voilà, c’est ça.
— Alors, je suis partant.
— Chouette, on va bien se marrer !











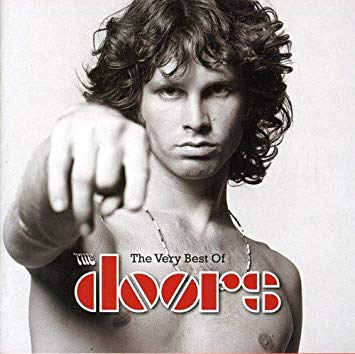

La dernière Nouvelle est vraiment hilarante et originale ! Merci d’avoir écrit cette rencontre complètement improbable !
Si son auteur, Pierre Malaval a d’autres textes à partager, j’aimerais beaucoup les lire 🙂
Ps : félicitations aux autres lauréats !
Un grand merci pour votre commentaire ! Je transmets votre compliment à l’auteur de la nouvelle 😉