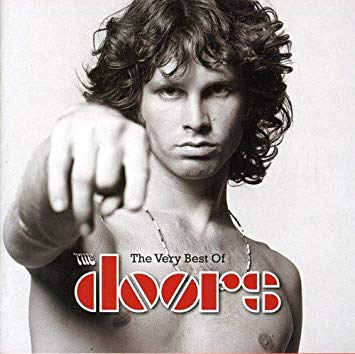Après Alfonso Cuarón, James Gray, Kenneth Brannagh et Almodóvar pour ne citer que les plus récents, c’est au tour de Spielberg de nous livrer son autobiographie en images. Avec un académisme soigné, mais sans se départir d’une certaine tendresse, le réalisateur de renom dévoile la naissance de sa vocation qu’il lie à l’éclatement de sa famille. Plutôt que se croire en possession d’un don ou d’un talent quelconque, Spielberg insiste sur l’aspect laborieux mais enthousiaste de ses débuts, et s’éclipse presque au profit d’un film drôle et touchant, une nouvelle fois façonné pour plaire au plus grand nombre.
La merveilleuse séquence d’ouverture de The Fabelmans suggère déjà le dysfonctionnement au sein du couple parentale. Face à l’enfant inquiet à l’idée d’assister à sa première séance, les deux parents se veulent rassurants, l’un par l’explication rationnelle de ce qu’est le cinéma et l’autre par l’appel au rêve. Cette opposition irrigue le reste du film et symbolise le déchirement du jeune Sammy, alter ego de Steven, entre son père, ingénieur sérieux, et sa mère, pianiste fantasque. Une fois revenue de la projection, Sammy cherche à reconstituer avec ses jouets la scène d’accident ferroviaire qui l’a effrayé et émerveillé. Aidé par sa mère, il parvient à la filmer et la projette sur ses deux mains jointes. De nombreuses autres scènes de projection seront distillées tout au long du film, comme pour suggérer que faire du cinéma se réduisait simplement à dompter la lumière.
Les premiers courts-métrages de Sammy sont projetés dans son armoire et rendent l’obscurité familière, et surtout, propices au spectacle. Ce lieu, première salle de cinéma en miniature, s’avérera ambivalent, puisque, si les films de fiction émerveillent, les œuvres plus intimes terrifient. Le cinéma est d’emblée présentée sous cette double facette, sa force d’enchantement reste indissociable de son pouvoir de révélation. Ainsi les gros plans centrés sur les personnages les présentent bien souvent les yeux grands ouverts, béats d’admiration, autant qu’au bord des larmes, ou pleurant même frontalement.
C’est là la double mission de The Fabelmans qui éblouit par sa maîtrise technique évidente, mais parvient à émouvoir. D’une part, Spielberg fait preuve d’un grand soin dans la retranscription de son enfance, l’atmosphère qu’il recrée apparaît étrangement édulcorée, presque fausse, comme une carte postale en mouvement. Peut-être voulait-il retrouver des souvenirs d’enfance parfaits, sous un verni rassurant, que seuls les pleurs des différents membres de la famille vient briser. La répétition des gros plans, accompagnée d’un éclairage souvent artificiel, traque la moindre émotion sur le visage des acteurs ; la mise en scène se met alors au service des acteurs prodigieux du casting, à commencer par Paul Dano et Michelle Williams. Lors d’un plan filmé en Super 8 (ou recréé au montage dans cette esthétique), l’actrice esquisse un léger faux sourire, alors que le père crie sa joie en la portant dans ses bras dans leur nouvelle maison. Ce détail, révélé par le gros plan, s’ajoute aux nombreuses fissures de ce verni idyllique. L’une des séquences suivantes, bouleversante, est celle de l’annonce du divorce.
Cependant, plus que Michelle Williams, c’est peut-être Paul Dano qui s’avère le plus bouleversant. Révélé dans Little Miss Sunshine, l’acteur semble comme en retenu jusqu’à l’annonce du divorce, et laisse éclater ses larmes dans la deuxième partie du film. L’une des dernières séquences, très touchante, le montre s’exiler au hors-champ pour ne pas que son fils le voit pleurer alors qu’il lui montrait, sans prendre garde, une photographie de sa mère avec son amant. Une nouvelle fois, l’image, en révélant, a un potentiel destructeur.
Le personnage de la mère de Sammy est construit pour émouvoir par sa légèreté et sa folie, mais semble parfois trop loufoque ou irréaliste pour toucher vraiment. La scène de danse dans le camping, par son aspect chorégraphié peu vraisemblable et la multiplicité des cadrages, se veut un exercice plus virtuose que réellement attachant, quand bien même la séquence est montrée comme centrale.
De manière plus générale, The Fabelmans pèche par ce type de séquences impromptues, bien plus que par des éléments structurels globaux. La dernière partie du film qui se déroule dans un lycée américain apparaît ainsi largement en-deçà des séquences précédentes. En effet, Spielberg cède à la facilité du manichéisme avec l’arrivée de personnages tirés de séries américaines pour ado, alors qu’une attention ténue aux différentes personnalités avait guidé le reste du film. Ce choix de personnages plus superficiels peut s’expliquer par la volonté de représenter un antisémitisme violent et vulgaire, ainsi que d’alterner les séquences plus douloureuses en famille par des purs moments de comédie grâce au personnage hilarant de Monica, fan absolue de Jésus. Résulte néanmoins de cette dernière partie une certaine déception, au vue de la qualité des séquences précédentes. Le personnage de Sammy adolescent, joué par Gabriel LaBelle, semble emblématique de ce tournant du film, beau, mais lisse.
Halte au génie !
Avec une modestie louable, Spielberg clôt son film autobiographique à son arrivée à la télévision. Jamais il n’est mention des Dents de la Mer, de Jurassic Park, La Liste de Schindler, Indiana Jones, Il faut sauver le soldat Ryan ou de nul autre de ses immenses succès qui ont fait de lui le cinéaste le plus rentable de tous les temps, et probablement l’un des réalisateurs ayant le mieux compris et anticipé les goûts du public. A la différence de ces grandes fresques et films d’aventure, The Fabelmans privilégie le petit spectacle, le drame intime, et apparaît plus proche d’E.T., notamment pour sa représentation tendre de la famille américaine moyenne. De surcroît, Spielberg ne se présente pas en surdoué de la réalisation, mais se peint en artisan de l’image. La solitude devient créatrice, et les différentes chambres occupées par Sammy Fabelman dans sa jeunesse s’apparentent à des ateliers miniatures. Le futur prodige invente sans cesse de nouvelles techniques pour surprendre ses premiers spectateurs et obtenir l’effet souhaité. Cette exigence fait de lieu non pas un génie, mais un passionné besogneux, déjà attentif à son public.
Si aucun de ses futurs succès n’est cité, Spielberg offre à l’inverse une place privilégiée à ses premiers projets, retranscrits de manière réjouissante. Le manque de moyens des débuts est compensé par l’enthousiasme de ses amis et les trouvailles de Sammy, qui retravaille parfois la pellicule même. Pourtant, rien dans ces sympathiques films de famille ou de fin de lycée ne laissent présager les grandioses spectacles de Spielberg, et le réalisateur se garde bien de les suggérer, préférant mettre en avant la joie collective de faire de films. Il n’est d’ailleurs pas surprenant à ce titre de voir qu’il a fait appel une fois de plus à John Williams, qui en fidèle acolyte, l’accompagne depuis un demi-siècle avec Les Dents de la Mer.
D’autre part, Spielberg se plaît à mettre le spectateur sur un pied d’égalité avec son personnage principal, comme une nouvelle preuve de son humilité dans cet autoportrait. Sammy découvre la liaison de sa mère avec un ami de ses parents en montant un film de famille, dans un geste hommage à Blow Up (1966) d’Antonioni, il laisse le spectateur comprendre en même temps que lui sa trouvaille, en agrandissant les rushs et en les répétant. La découverte tragique de Sammy se double d’une mise en scène ludique, toujours gratifiante pour le spectateur. Lors de la projection du film de fin d’année devant son lycée, la posture de Sammy semble symboliser le souhait de Spielberg de s’effacer au profit de l’identification à des héros glorieux. Mais il suggère aussi, dans une forme de mise en abyme ironique quand il prétend ne jamais révéler le secret de son ennemi, qu’il reste le maître d’orchestre de ce petit monde rassurant.
Cet ethos modeste que se prête Spielberg durant tout le film atteint son point d’orge dans la séquence finale fabuleuse, en forme de double hommage. Sammy Fabelman arrive par hasard dans le bureau d’une de ses idoles. Un mouvement panoramique en caméra subjective dévoile toutes les affiches des films réalisés par John Ford, avant de s’arrêter sur L’homme qui tua Liberty Valance, que le jeune cinéphile a pu voir au cinéma. Sa rencontre avec ce cinéaste de renom, véritable monument du cinéma classique hollywoodien, donne lieu à une idée assez géniale de Spielberg de faire jouer Ford par un autre réalisateur de talent, David Lynch, et réunit ainsi deux pans du cinéma américain. Spielberg semble avouer sa modestie entre ces deux légendes. On retrouve le même type d’hommage que dans Rencontre du troisième type où le réalisateur avait choisi Truffaut pour jouer un des personnages centraux. Le dernier plan du film est par ailleurs très touchant, la caméra opère un mouvement vertical bref, comme une correction rapide du cinéaste pour suivre le conseil donné par John Ford quelques instants plus tôt. Steven Spielberg, dont les fims cumulent près de 100 millions d’entrées rien qu’en France, se présente, une fois de plus, en humble élève de plus grands maîtres.
En bref
Si quelques faiblesses au niveau du scénario et de l’esthétique parfois artificielle empêchent de qualifier The Fabelmans de chef d’œuvre, il reste un film sincère et touchant sur la famille et les pouvoirs ambivalents du cinéma. Nul doute que ce film fera date dans la série des longs-métrages autobiographiques dont Hollywood raffole, ainsi que dans la filmographie de Spielberg. Si le public américain a boudé l’histoire de ce self-made man modeste qui l’a tant fait rêvé, espérons que le box-office français saluera ce film au charme indéniable, qui n’oublie pas de remercier ses prédécesseurs à qui il doit tant.