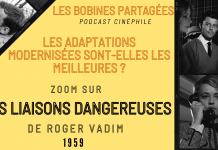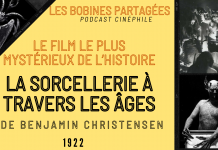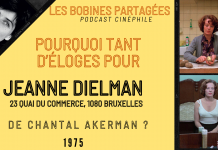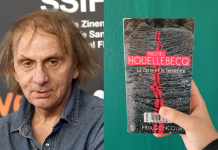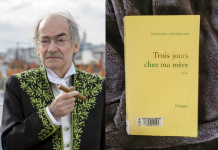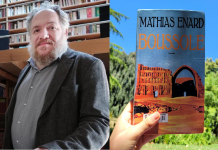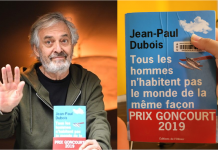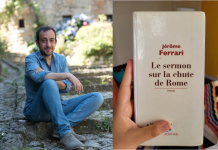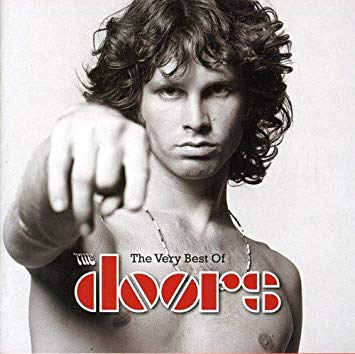De Yukio Mishima je ne connaissais essentiellement que la fin, d’un spectaculaire morbide. En 1970, le jour même de la remise de son dernier manuscrit, l’auteur japonais, icône encensée dans le monde entier, se suicide en public, par hara-kiri, puis décapité. Il avait annoncé sa fin dans plusieurs ouvrages ainsi que dans un court-métrage. 45 ans, mort d’une icône controversée de la littérature, pressenti plusieurs fois pour le Nobel pour sa recherche sensuel et stylistique de la beauté suprême, aussi fervent nationaliste, et expert en arts martiaux. Que nous racontent ses livres quand sa vie ressemble à un roman ?
Un petit tour à la médiathèque et me revoilà avec Le Pavillon d’or (1956) qui me passionna, et me fit emprunter naturellement un autre, Confessions d’un masque (1949).
En 1950, un jeune moine bouddhiste détruit le Pavillon d’or, sublime temple de plus de quatre siècles, ravagé par les flammes. Six ans plus tard, Mishima s’empare de cet événement pour déployer une réflexion passionnante sur la beauté. Le personnage principal, Mizoguchi, souffre de sa laideur et de son bégaiement. Devant le Pavillon d’or, il se sent acculé, humilié par ce bâtiment vanté pour sa splendeur. Animé par le ressentiment, il entreprend d’y mettre le feu.
La quête vengeresse du jeune moine permet à Mishima d’entrer en profondeur dans des considérations complexes sur le Beau, sans jamais nous perdre, car ses pensées restent corrélées à la fiction, à des événements. Nul tunnel de dix pages sur un Beau abstrait, mais, toujours, des faits, des personnages, des dialogues. Ne croyez pas pour autant que l’auteur illustre platement des concepts à travers de banales situations, Mishima trouve l’équilibre parfait, entre subtilité de la pensée, clarté de l’expression et crédibilité de la fiction.
On peut lire Le Pavillon d’or en appréciant ces trois dimensions, ou en ne s’attachant qu’à une seule, réflexion, beauté de la langue, ou histoire intrigante. Chaque événement traversé, chaque personnage rencontré par Mizoguchi prolonge les interrogations de l’auteur sur la beauté, à la fois impossible et évidente. Comment évolue sa folie lorsqu’il se lie d’amitié avec un autre jeune, censé être meilleur que lui ? Ou un second, jugé laid également ? Jamais Mishima ne nous perd dans de vagues abstractions. Pour s’y faire, il prête une grande attention au corps, à la sensualité, aussi la Beauté et la Laideur s’incarnent presque physiquement.
« Pourquoi, me demandais-je, n’avais-je pas songé à assassiner le Prieur avant d’envisager l’incendie du Pavillon d’or ? (…) Aussi raisonnais-je, et mes réflexions me firent apparaître une indéniable et totale différence entre l’existence du Pavillon d’Or et celle de l’être humain. D’une part, un simulacre d’éternité émanait de la forme humaine si aisément destructible ; inversement, de l’indestructible beauté du Pavillon d’Or émanait une possibilité d’anéantissement. » Le Pavillon d’Or
Impressionnée par cet esprit subtile, me voilà lancée dans Confessions d’un masque. Il s’agit du premier roman de Mishima, probablement son plus célèbre aujourd’hui. A travers le personnage de Kochan, double de papier de l’auteur, Mishima raconte la douleur d’être un homme homosexuel dans le Japon des années 1930. Comment prendre le masque d’un hétérosexuel rangé quand ses pulsions hurlent le contraire ? Dans ce récit inspiré de sa propre vie, Mishima nous plonge dans les pensées douloureuses et contradictoires d’un jeune homme, conscient de son désir.
« Depuis cette époque, telle a toujours été mon attitude en face de la vie : s’agissant de choses trop attendues, trop embellies par des rêveries anticipées, je ne puis en définitive rien faire d’autre que de prendre la fuite. » Confessions d’un masque
Comme Le Pavillon d’Or, Confessions d’un masque me frappe par les réflexions subtiles du personnage, ce balancement si juste entre intrigue romanesque et plongée dans l’intériorité. Mishima s’empare des concepts de honte, de désir, d’illusion, et évite l’abstraction comme la banalité. Ces deux ouvrages saisissent des paradoxes, et ne balaie aucune ombre.
Si au niveau de la langue et des thèmes abordés, les livres de Mishima me semblent accessibles, je les conseillerais plutôt à des lecteurs confirmés. Ces deux romans, superbes, explorent des pensées, aussi l’intériorité prend le pas sur l’histoire. Amateurs de péripéties et d’intrigues, passez votre chemin, ces livres sont denses pour les réflexions plutôt que pour les actions. Ils n’en restent pas moins passionnants, évidemment, alors… osez !