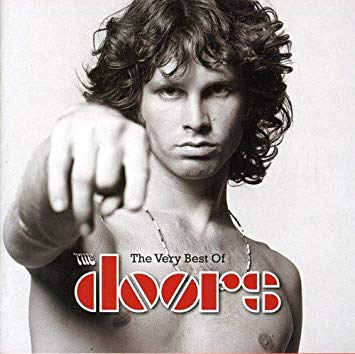Terence Davies nous livre un ultime film complexe et déconcertant sur la vie de Siegfried Sassoon, poète marqué par la violence des hommes, à la guerre comme en amour.
Décédé peu après ces Carnets dont il ne verra pas la sortie en France, Terence Davies consacre son dernier film à Siegfried Sassoon, poète relativement méconnu Outre-Manche. Survivant des tranchées qui lui ôtent son frère et sa joie de vivre, Sassoon devient objecteur de conscience. Ses relations lui évitent la cour martiale, mais il est sommé de guérir de sa dépression dans un hospice écossais. La fin de la guerre marque son retour dans les soirées mondaines où se succèdent ses aventures amoureuses homosexuelles.
Le biopic sensoriel
Si les biopics sur les génies de la musique se succèdent avec plus ou moins de succès, ceux sur les écrivains se font plus timides. Ces dernières décennies, se sont succédés sur nos écrans les vies de Tolkien, John Keats (Bright Star), ou encore Virginia Woolf (The Hours) et rare exemple français, Romain Gary (La Promesse de l’aube). Il faut avouer que Siegfried Sassoon ne jouissait pas de la même notoriété que ces illustres noms, ce qui, paradoxalement, a probablement laissé plus de liberté à Terence Davies.
En effet, Davies s’éloigne du biopic-Wikipédia – qui avait l’avantage de la clarté – pour un film plus ambitieux et non-linéaire qui mélange images d’archives de la guerre et prises de vues réelles faussement traditionnelles. Le début du film est un condensé quelque peu artificiel de ce choix de mise en scène étonnant, mais finalement convaincant. Bien que les images d’archives brisent sans cesse le processus d’illusion que le cinéma est censé créer, elles arrivent par touches fugaces, comme un refoulé impossible à dépasser. Ce montage, parfois abrupt, suggère le traumatisme de Sassoon qu’on ne verra que rarement montrer sa douleur.
Ce montage déconcerte, et nous place dans l’esprit malade de Siegfried. A la cohérence du biopic traditionnel plus explicatif, Terence Davies préfère créer une expérience plus sensible, voire sensorielle.
La représentation de la guerre donne lieu aux expérimentations les plus intéressantes du film. On pense parfois au dispositif de l’art contemporain, notamment à la fin du film, lorsque que Siegfried âgé est placé devant un filtre sur lequel sont projetées les images de la guerre.
Lors d’une séquence virtuose, nous découvrons Siegfried au lit, un livre à la main, puis un mouvement panoramique nous plonge dans une reconstitution glaçante d’un de ses souvenirs. Des soldats blessés hurlent à la mort dans une infirmerie de fortune, faiblement éclairée. Cut, et plan fixe : les lits sont désormais vides, quelques traces de sang trahissent la présence de leurs précédents locataires. Au-delà de la beauté de ce mouvement de caméra, la séquence marque par la représentation frontale des horreurs de la guerre. Elle apparaît même comme le symbole d’un film jouant sur cette absence/présence de la guerre, sans cesse dans un coin de l’esprit grâce au montage, mais évitée dans les discussions. Et, plus dommageable, dans les deux tiers du film.
En mal d’amour ou mal aimé ?
En effet, Les Carnets de Siegfried finissent par délaisser la représentation de la guerre, pour s’attarder sur les amours de Sassoon. Les liaisons s’ensuivent sans grande cohérence, dans un ronronnement répétitif. Comment comprendre cette importance démesurée accordée à ces séquences ?
La réponse se situe peut-être à la fin du film. Sassoon, désormais vieux grincheux dépassé, regarde la pluie par la fenêtre. Apparaissent en surimpression les visages des seuls êtres qui furent bons avec lui, comme Wilfried Owens, Glenn, son ami Robbie, et sa mère. Or, nous avions été privés de ces moments heureux, la joie de Siegfried n’est présente que dans les ellipses. Sassoon, détruit par la Première Guerre Mondiale, est coupable d’avoir survécu. Les images d’archives, possibles représentations de son inconscient, reviennent comme une litanie ironique pour lui rappeler sa peine. Alors, dans un mouvement de compensation aux tendances sando-masochistes, Sassoon n’a pas donné sa chance aux personnages bons, mais a persisté dans le mal. Au lieu d’amants tendres, il n’a choisi que des hommes mesquins et détachés. A la violence des hommes sur le front, s’est succédée celle des hommes des salons ?
Terrence Davies emprunte à Proust dans cette représentation ironique de ces êtres mondains, palots derrière leurs apparats. Les dialogues du film, faits de messes basses et de piques assassines masquées, sont d’un extrême raffinement qui finit par lasser. De même, la masse de références qui peuple les répliques agace et s’avère vaine. Jamais nous n’aurons accès à la vérité de ces êtres – si tant est qu’ils en aient une.
Une des séquences mettant en scène son dernier amant, Stephen, nous donne peut-être une clef de compréhension du film. L’homme se maquille devant un miroir, dans une posture d’extrême rigidité. D’une voix atone, il clame sans honte son désir de rester éternellement beau. Ce jeu de double est une référence directe à Dorian Gray, le personnage d’Oscar Wilde, par ailleurs convoqué à plusieurs reprises dans le film. Tous ses personnages traumatisés par la guerre, coupables d’être rentrés vivants, refusent de vieillir, car ce serait voir leurs corps les traces de leur survie. Après le changement absolu qu’a représenté la guerre, Siegfried trouverait dans ces liaisons malheureuses, une répétition visant à recréer une stabilité, une ère immuable, même si celle-ci trouve ses fondations dans le mal.
Toutefois, le film échoue à nous émouvoir réellement. Si la présence des images d’archives brise constamment l’immersion dans le film, c’est surtout le personnage de Siegfried lui-même qui peine à susciter l’empathie, d’autant plus que le film se termine sur un Sassoon vieux, désagréable à l’excès. Aussi le film s’achève péniblement, dans une succession de climax peu efficaces. L’élément final le plus intéressant est la présence de la voix off de Siegfried lisant un poème de Wilfred Owen, son premier amant dans le film. Wilfred Owen meurt à 25 ans dans les tranchées, Sassoon restera ébranlé par cette disparition précoce. Cependant, cette lecture dépasse le simple hommage et met en lumière le paradoxe de la vie de Sassoon. Siegfried survit et écrit sur la guerre, mais le poème le plus marquant du film est celui de Wilfred Owen, par ailleurs considéré en Angleterre comme le plus grand poète de 14-18. Sassoon, en larmes, semble prendre conscience qu’il n’a peut-être pas été à la hauteur de sa survie.




![Perfect Blue (1997) : vingt ans avant #MeToo, Satoshi Kon avait-il vu juste ? [podcast]](https://www.lecercledesrockeursdisparus.com/wp-content/uploads/2024/10/conformiste-miniature-yt-1-218x150.png)
![Le Conformiste (1970) de Bertolucci : une leçon de photographie [podcast]](https://www.lecercledesrockeursdisparus.com/wp-content/uploads/2024/08/1-site-218x150.png)
![Haneke : par quel film commencer ? [podcast]](https://www.lecercledesrockeursdisparus.com/wp-content/uploads/2024/08/YouTube-Haneke-218x150.png)