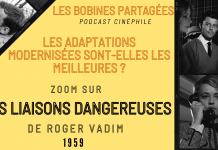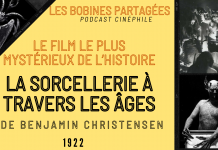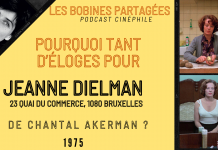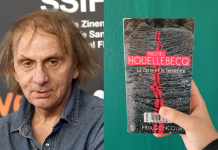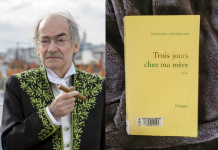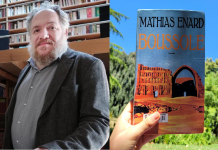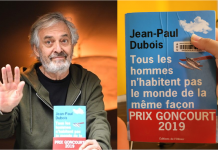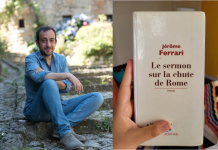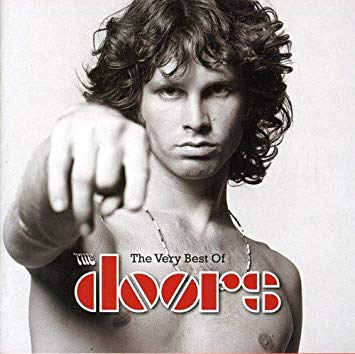Que voir en octobre ? Les sorties du Festival de Cannes s’enchaînent, à commencer par la Palme d’Or tant attendue de Jafar Panahi, tandis que s’invitent sur nos écrans quelques blockbusters à la française, malheureusement un peu en demi-teinte (Chien 51, L’Homme qui rétrécit, Yoroï). Un mois de cinéma en dents de scie, porté, comme toujours, par de jolies découvertes (Météors, La Petite Dernière), et de francs coups de coeur (Nouvelle Vague, House of Dynamite).
Un simple accident de Jafar Panahi
Palme d’or quasi annoncée dès sa sélection au Festival de Cannes, et effectivement récompensée par le jury de Juliette Binoche, Un simple accident tient ses promesses. Jafar Panahi retrouve l’élément structurel de son cinéma, et même du cinéma iranien, à savoir la voiture, pour compter l’errance d’une petite troupe de rescapés de la torture qui croient avoir capturé leur ancien bourreau. Avec de gros sabots didactiques certes, le film oppose les partisans de la revanche à ceux de la reconstruction, dans un débat plus politique encore qu’il n’y paraît, car déjà situé dans un régime post-talibans, pourtant loin d’être démis à ce jour.
Ce propos politique s’incarne dans des trouvailles cinématographiques un peu simples (contexte tendu de tournage oblige) mais efficaces : des jeux de mouvements de caméra et de cadrage qui isolent les personnages dissidents du groupe, une exploitation efficace du hors-champ et surtout, un bruitage d’anthologie qui ouvre et clôt le film, dans une atmosphère paranoïaque qui nous plonge, sensoriellement, dans une dictature.
L’homme qui rétrécit de Jan Kounen
Film très étrange que ce remake d’un film hollywoodien des années 1950 signé par Jack Arnold. Dans le film originel, un homme irradié par erreurs par un mystérieux nuage nucléaire perd quelques centimètres par jour, avant de se retrouver aussi petit qu’un enfant, qu’un jouet, qu’un insecte. Devenu minuscule, il lutte pour survivre face à un monde miniature devenu terrifiant, et en même temps merveilleux, car découvert sous un nouvel angle. Jan Kounen s’empare de cette histoire aussi fantastique que métaphysique en faisant appel à Jean Dujardin, jamais à court d’expériences étonnantes d’acteur, dix ans après Un homme à la hauteur. Le résultat s’avère un peu bancal, à cause d’un cruel manque de second degré et une écriture faiblarde des personnages secondaires. Le mélange des genres, de la stupéfaction à l’horreur pure, ne fonctionnera qu’à condition d’être pleinement immergé au plus près de Dujardin qui lui, reste assez convaincant dans ce rôle si détonnant.
Météors d’Hubert Charuel et Claude Le Pape
En termes de films pas très rigolos sur la campagne, ce duo de cinéastes avait fait fort avec Petit Paysan (2017). Refusant d’être enfermés dans un registre, dans un type de représentations, il renouvèle leur discours sur la diagonale du vide avec Météors, charmante comédie, aux allures de buddy movie, flirtant toujours avec la chronique sociale. Après un plan foireux (kidnapper un chat de luxe pour le revendre), deux potes se retrouvent devant un juge qui leur donne six mois pour changer de vie : arrêter de fumer, de boire, bref de glandouiller. Les deux lascars, pistonnés par un troisième larron, débarquent sur un chantier d’enfouissement de déchets nucléaires. Fin du rire, le film se renouvelle et dresse un parallèle entre les corps malades, les territoires intoxiqués et les amitiés toxiques. Si on peut saluer l’ambition de la proposition, il faut avouer que le mélange des genres tient difficilement la durée, jusqu’à une fin qui tente maladroitement de raccrocher tous les fils.
Pour en savoir plus, retrouvez ma critique complète sur Zone critique juste ici.
House of Dynamite de Kathryn Bigelow
Avec une petite bande de privilégiés tirés au sort par la Cinémathèque, j’ai pu voir le nouveau film de Kathryn Bigelow en salle, sur grand écran, alors que le film est uniquement disponible sur Netflix. Je serais curieuse de savoir si les effets suscités par le film sont aussi violents si on le voit dans son salon (n’hésitez pas à vous emparer de la section commentaire pour partager vos expériences !). Pour ma part, comme toujours devant les films de Bigelow, j’eus le souffle coupé. Dans House of Dynamite, un missile nucléaire risque de s’abattre sur les Etats-Unis. Dans un montage à la Rashômon de Kurosawa, où un même événement est vécu par plusieurs points de vue, on suit ici la cellule de crise à travers chacun de ses membres. A l’instant où le missile va heurter Chicago, Bigelow, avec un malin plaisir, reprend au début, à travers de nouveaux yeux. La frustration grandit parallèlement à l’angoisse de l’événement à venir, sans que l’on aie de réponses finales. Il me semble que Kathryn Bigelow, avec maestra, trouve un équivalent esthétique à l’équilibre de la terreur. Elle maintient une tension quasi insoutenable, sans que rien n’aboutisse. Comme lors d’une crise diplomatique autour des armes nucléaires. Le résultat est politique, nerveux, et agaçant certes. Nul doute qu’il opposera vivement les spectateurs.
Pour en savoir plus sur ce film, découvrez ma chronique complète juste ici.
Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson
Etonnante proposition que ce film, dans la droite lignée des comédies burlesques et déjantées des frères Coen. On croirait DiCaprio, looser magnifique en peignoir ridicule tout droit sorti de The Big Lebowski. De même, Benicio Del Toro, ici expert d’arts martiaux à la cool, ne jurerait pas dans Burn After Reading ou Barton Fink. Le ton même du film, loin de la grandiloquence parfois pompeuse des grands films de Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Phantom Thread), tend vers un comique de bande dessinée, loufoque et haut en couleur. Après un prologue mené tambour battant, dans lequel DiCaprio incarne un jeune militant d’extrême-gauche amoureux de la charismatique cheffe révolutionnaire (Teyana Taylor), le film change de rythme et installe une plus traditionnelle course-poursuite à la recherche de la fille de notre anti-héros (Chase Infiniti). Le potentiel politique du début s’efface donc au profit d’intrigues familiales et intimes, malgré la présence (caricaturale à souhait) de Sean Penn en suprémaciste blanc plein de contradictions. Tantôt cabotin, le film tient la durée avec brio, grâce à un mélange d’humour et d’action savamment dosé. On regrettera la progressive dépolitisation du film, surtout au vu d’un prologue joyeusement antifasciste, rarement vu avec tant de frontalité dans le cinéma américain contemporain.
Moi qui t’aimais de Diane Kuris
Bien plus surprenant encore que ce biopic en porte-à-faux, qui assume d’emblée son artificialité en montrant Marina Foïs et Roschdy Zem qui se maquillent et s’installent dans leurs personnages, mythiques s’il en est, de Simone Signoret et d’Yves Montand. Impossible une seconde de croire à ceux deux-là, d’autant plus que Diane Kuris parsème le film d’archives d’origine, avec les acteurs réels, qui ne ressemblent pas pour un sou à Marina Foïs et Roschdy Zem. Autant on ne croit pas à Signoret et Montand à l’écran, autant on croit parfois au couple de personnages. Le film nous frappe par brefs instants par ses éclats de violence et de tendresse mêlées, rythmés par les infidélités constantes de Montand. Moi qui t’aimais s’affirme pleinement du côté de Signoret, et tente de ne pas la réduire à un statut de victime. La galerie de seconds rôles, les allusions aux films respectifs de l’un et de l’autre, ainsi que les reconstitutions des tournages sont censés nous faire croire davantage en Signoret et Montand à l’écran, mais paradoxalement, à cause de l’absence de ressemblance flagrante, nous sortent du film. Peut-être que choisir définitivement l’artificialité et ne présenter le couple que dans son intimité auraient donné un film plus cohérent.
Chien 51 de Cédric Jimenez
Cédric Jimenez parvient à un étrange paradoxe : faire un excellent film d’action, mais un mauvais film de science-fiction. On retrouve la nervosité des courses-poursuites de Bac Nord et de Novembre, mais cette adaptation du roman de Laurent Gaudé perd toute substance politique, et ne parvient pas à se hisser au niveau des ses modèles, Minority Report et Blade Runner en tête. Cette petite déception s’explique par un scénario trop prévisible, complètement dépolitisée, et presque anachronique sur le sujet de l’intelligence artificielle.
Retrouvez ma critique complète sur Zone critique juste ici.
Nouvelle Vague de Richard Linklater
Le biopic, non de Godard, mais du film A bout de souffle, évite nombre d’écueils attendus : vénération du maître, mythification du tournage, sublimation de tout anecdote. Seul subsiste le plaisir de faire des films, tous ensemble. Les galères se muent en anecdotes truculentes, et la pulsion mégalomaniaque de Godard est tournée en ridicule. Grâce à l’utilisation de cartons indiquant seulement le nom des personnages, Nouvelle Vague se situe sur une ligne de crête intéressante, entre son envie de faire connaître cette génération brillante, somme d’individus remarquables et inventifs, et son désir de s’adresser au grand public, sans le noyer de références non explicitées. Ce dispositif invite à prolonger son visionnage par la découverte des films de la nouvelle vague, à commencer par A bout de souffle, que le film de Linklater ne survend pas, ne magnifie pas, mais en offre un regard amoureux, à l’enthousiasme communicatif.
La petite dernière d’Hafsia Herzi
Un joli film porté par l’interprétation sincère de Nadia Melliti (premier rôle, premier prix et pas des moindres : celui d’interprétation à Cannes). Hafsia Herzi saisit un sujet aujourd’hui balisé par le cinéma contemporain : la découverte de l’homosexualité par une jeune femme, et sa difficulté de le dire, difficulté réhaussée ici par la religion musulmane de sa famille. La réalisatrice évacue les lourds non-dits pour préférer un récit solaire sur le désir. Son empathie pour le personnage se ressent dès le début du film qui s’amuse à mentionner oralement tous les fantasmes sexuels liés aux lesbiennes pour mieux les éviter par la suite, comme si le film cherchait d’abord à protéger ses personnages, sans puritanisme pour autant. D’étranges passages sur l’asthme du personnage principal sont l’occasion, comique et presque retorse, de représenter des objets phalliques comme clairement repoussants et risibles, et les hommes, comme des êtres un poil ridicules. La petite dernière n’est pas un film révolutionnaire, surtout après la déferlante Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, dont le regard naturaliste plane dans l’œuvre d’Hafsia Herzi, qui a débuté sa carrière chez lui, en tant qu’artiste. Cependant, La petite dernière reste en tête, en cœur, par son personnage principal éblouissant et la simplicité de son regard joyeux.
Yoroï de David Tomaszewski, co-écrit avec Orelsan
Film hybride, entre l’egotrip conscient d’un artiste au bord du burn-out, et film comique d’action dans la veine des blockbusters familiaux type Goonies, Yoroï oscille entre l’autofiction dédiée aux fans et le divertissement grand public, un peu cheap hélas. Résulte un étrange objet, ponctué par les chansons d’Orelsan, dont le double de fiction craint autant le succès étourdissant que la paternité à venir. Les passages plus autobiographiques s’avèrent finalement plus intéressantes et universels que les séquences d’action, un peu grand guignol.